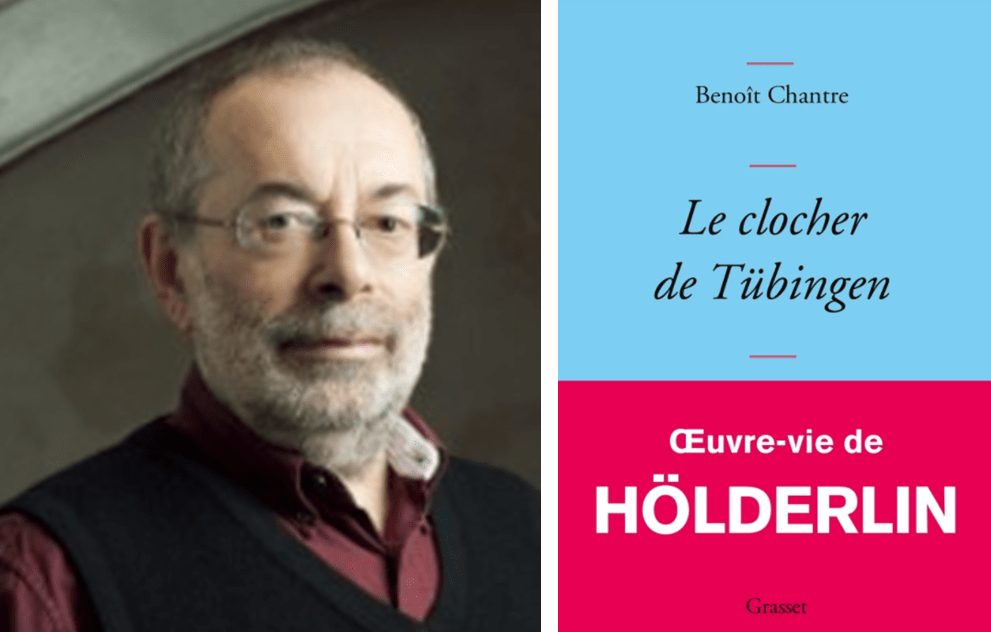Nous reprenons un essai du général (2S) Jean-Louis Esquivié, initialement paru dans le Revue politique et parlementaire).
Période improbable, incertaine, période stressante, sans horizon pour les populations qui depuis des mois, des années, à présent, privées de leurs repères basiques voire personnels, n’ont pas d’autre choix que de confier leur sort et la conduite de leur vie quotidienne aux directives de gouvernances politiques, elles-mêmes partagées et en déficit de confiance.
Que croire, qui croire, comment penser juste alors que bombardées chaque jour d’informations contradictoires, les populations subissent de façon concomitante trois crises majeures : la guerre, le réchauffement de la planète, la pandémie ? La particularité contemporaine de ces trois crises est qu’elles sont moins locales que mondialisées en ce sens qu’elles impactent sous des formes diverses l’ensemble des populations du globe. Il faut comprendre cette situation présente à l’aune de l’imbrication certaine de ces crises tant par leurs causes que par leurs effets (la peur) en particulier sur les postures et décisions des gouvernances. Il est évident que ces trois crises deviennent des menaces pour les populations imputables au côté ‘’Janus négatif‘’ de ce monde. Les entrées sont multiples mais corrélées : homme malade, terre souffrante, violence exacerbée. Le premier lien qui saute aux yeux est la finalité létale de tous ces maux : la mort rendue possible par le naturel ou l’artificiel (l’homme). Il n’est jamais trop tard pour canaliser toutes les énergies, les dynamismes, les pensées, les solutions dans un brainstorming mondialisé en vue d’endiguer puis stopper ce tsunami à répliques avant qu’il n’embrase le monde définitivement.
Parlons de la guerre
Les pays ont institué un forum mondial de l’économie à Davos pour régler ensemble et en commun les problèmes les plus urgents de la planète. Pour traiter des problèmes de la guerre, pourquoi ne pas rêver d’un Davos ou un équivalent qui réunirait des responsables militaires de tous les pays avec un sujet unique : comment faire et garantir la paix ? Le militaire digne de ce nom a pour vocation d’être le premier rempart, au prix de sa vie, de nature à assurer la protection de ses concitoyens contre une violence extérieure menaçant le pays.
‘’Si vis pacem para bellum’’. Si tu veux la paix, prépare la guerre.
Ce concept énoncé par les penseurs de l’époque romaine et qui n’a pris à ce jour aucune ride est en soi une véritable philosophie. Toute la noblesse et le devoir de l’état de soldat sont liés aux entretiens et perfectionnements continus aux fins de maintenir un niveau de défense en mesure de dissuader tout agresseur potentiel ou prédateur. Comment ne pas saluer la déclaration du nouveau chef d’état-major de l’armée française, le général Burkhart qui définit sa doctrine pour la Défense française comme suit : « Il faut gagner la guerre avant la guerre » ? Cet objectif est aussi empreint de philosophie, puisqu’il vise la non-guerre par une certaine posture qui concerne l’ensemble des citoyens à observer dans l’avant-guerre. Le général poursuit avec un commentaire important tant il convient à la situation présente : « Avant, les conflits s’inscrivaient dans un schéma ‘’paix- crise- guerre‘’, désormais c’est plutôt ‘’compétition, contestation, affrontement’’ ».
Changement d’époque. Clausewitz l’avait pressenti et le philosophe René Girard l’a démontré. La formule historique de Clausewitz déclarant que la guerre n’est rien d’autre que la continuation de la politique par d’autres moyens est possible à son sens par le bon fonctionnement de ce qu’il appellera l’étonnante trinité : le peuple se soumet au militaire qui lui-même se soumet au politique. Changement d’époque : la formule ne marche plus dans le même sens, tel est le premier enseignement de la guerre actuelle.
Parlons de la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine
Certes les médias, écrits et parlés, ont abondé de commentaires, fait des hypothèses, proposé des analyses, envisagé des solutions si diverses sur un sujet éloigné de leurs préoccupations quotidiennes sociétales que l’auditeur s’en est trouvé désorienté. Petit à petit dans les rédactions a été prise en compte l’opinion de responsables militaires, qui ont apporté à l’analyse des jugements professionnels et factuels. Cette source d’inspiration guide cet essai pour aider à comprendre cette guerre, suggérer des principes d’action et n’espérer in fine que dégager une voie vers la paix.
Le 24 février 2021, après avoir concentré des troupes nombreuses autour des frontières de l’Ukraine, la Russie, malgré les réunions, les conciliabules, les avertissements, a attaqué l’Ukraine. La raison évoquée pour justifier cette agression a été une promesse non tenue par les occidentaux faite au président Gorbatchev au moment de la fin de la guerre froide (1991) de ne pas étendre l’Otan, l’organisation militaire occidentale, jusqu’aux frontières de la Russie. L’Ukraine libérée du joug soviétique, séduite par la vie occidentale, a forgé année après année son indépendance vis-à-vis de la Russie en se rapprochant de l’Union européenne jusqu’à souhaiter l’intégrer et partant, d’être un jour membre de l’Otan sur le plan militaire. On ne peut oublier que la Russie avait averti depuis de nombreuses années qu’elle n’accepterait pas cet état de fait. Le temps passant n’a rien effacé et l’impensable est arrivé.
Ce choix du passage à l’acte russe en ce début d’année 2022 est fatalement stratégique : opportunité de temps, de circonstances, de moyens, de forces en présence, de politique.
Le premier constat incombe à l’Occident de devoir verbaliser, malgré les bonnes informations des services, son échec à n’avoir pu empêcher ce conflit : ultime leçon clamée par le général Burkhart : « Il faut gagner la guerre avant la guerre ».
Que nous dit donc cette guerre ?
Certes rien de bon en primo analyse : mais cette guerre draine des paramètres nouveaux caractéristiques d’une situation jamais vue à ce jour et d’un potentiel de dangerosité extrême. Ce conflit démarre de façon classique : la guerre débute par une déclaration de guerre (pas tout à fait dans ce conflit ; affaire de sémantique), puis naît la guerre avec son cortège de dégâts et atrocités pour théoriquement aboutir au cessez-le-feu et, in fine la paix. Le dernier exemple : le conflit (2020) entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, lequel après six mille morts, s’achevait sur la signature d’un accord entre les deux partis. En revanche, il apparaît que ce conflit n’a rien de classique à l’aune des éléments suivants : le pays agresseur possédant l’arme nucléaire attaque son voisin au motif de sa proximité complice avec une alliance de pays dont trois d’entre eux ont l’arme nucléaire. Ce conflit perd sa virginité classique le 27 février 2022 avec ces propos du président de la Russie : « J’ordonne au ministre de la Défense et chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion en régime spécial d’alerte au combat ». Cette déclaration inquiétante est corroborée par plus angoissant à l’attention de ceux qui pourraient être tentés d’intervenir de l’extérieur, menacés alors de subir « (…) de telles conséquences que vous n’avez jamais vues dans votre histoire. »
De ce que l’on sait des procédures russes sur le nucléaire, on estime à quatre niveaux leur montée en puissance. La déclaration du 27 février place le curseur au niveau deux, dit ‘’niveau d’alerte’’, le troisième niveau étant celui dit du ‘’danger militaire’’ et le dernier étant celui de ‘’la guerre’’. Le processus enclenché est confirmé à l’occasion de la déclaration du ministre de l’économie Bruno Lemaire, décrétant la guerre économique à la Russie et se faisant reprendre solennellement par Dimitri Medvedev, ancien président de Russie avec ces termes : « Faites attention à vos discours, messieurs, et n’oubliez pas que les guerres économiques se sont souvent transformées en guerre réelle. »
Ces déclarations à la suite, dès la première semaine de combat, donnent une signification grave et inédite à cette guerre qui ne peut plus être classique au regard de cette menace exprimée de violences possibles jamais vues dans l’histoire.
L’intrusion nucléaire subliminale dans ce conflit change sa nature et fait entrevoir un cheminement de l’affrontement classique à l’apocalypse nucléaire. Le commun des mortels a le droit de croire, pour vivre sereinement, à un coup de bluff de la part du président russe, mais cette posture est interdite aux responsables politiques et militaires. En effet, il est de leur responsabilité pour leurs peuples d’intégrer ces menaces dans toutes leurs dimensions y compris celles générées par leurs propres négligences et erreurs, aux fins de mieux appréhender un monde inconnu.
Quel monde ?
Un monde irrationnel et déraisonné où la vie réelle n’a plus d’avenir, puisque l’échange de politesses n’est alors plus envisageable que par des bordées d’engins nucléaires propres à exterminer l’humanité. Le nucléaire tue la relation humaine. La bombe atomique est à la guerre classique ce qu’est le quantique à la physique classique. Le langage des médias s’adapte au phénomène avec ce titre d’un quotidien : « Quelle est la probabilité que ce conflit devienne nucléaire ? » La guerre classique est affaire de rapport de forces, de stratégies et d’enjeux politiques ; tous éléments qui se pèsent et se mesurent. En revanche, pour situer la possibilité du nucléaire, un raisonnement rationnel n’étant pas adapté, il faut convoquer les probabilités pour situer cet évènement court et programmé capable de déclencher l’apocalypse.
La France est aussi devenue une puissance nucléaire (1960) par la volonté du général de Gaulle à des fins fondamentalement politiques et du rang à retrouver pour notre pays. Ce sont évidemment les militaires qui sont responsables des composants, de la logistique et de la mise en œuvre de la chaîne nucléaire dont le service est fait de processus à suivre et d’opérations programmées hors du champ intellectuel et décisionnel. L’auteur de ces lignes a servi dans les années 1970 une arme nucléaire tactique de conception américaine dite ‘’Honest John’’. Ce système d’arme était composé d’une rampe de lancement à partir de laquelle une roquette pouvait délivrer à 40 kilomètres une charge nucléaire de 20 kilotonnes, c’est-à-dire une puissance équivalente à la bombe d’Hiroshima. La rampe était servie par une équipe commandée par un officier, un lieutenant en général. La séquence de tir entre l’assemblage de la roquette, son transport et son chargement pour le tir nécessitait sept heures. En revanche, la séquence de tir occupait la dernière heure du processus qui était de la responsabilité de ce lieutenant, chef de rampe. Nous fûmes quelques officiers à nous poser un vrai grand problème existentiel dont nous avions cherché la réponse auprès de notre hiérarchie, en l’occurrence le colonel commandant ce régiment composé de quatre rampes. Le questionnement était le suivant : « Si nous, lieutenants responsables d’une rampe, rentrons dans le processus de la dernière heure avant le tir et que nous perdons en ce même temps la liaison avec notre hiérarchie, quelle est notre conduite à tenir ? » Après consultation, le colonel, chef de corps nous fit la réponse suivante : « Vous tirez quand même ! »
Pour les jeunes officiers que nous étions, conscients de nos devoirs et responsabilités, cette réponse fut improbable et insensée. En fait, il fallait comprendre que les règles du combat classique étaient appliquées au nucléaire parce que ce moyen apocalyptique leur avait été confié en tant qu’arme nouvelle, certes un peu plus efficace que les autres. Ce raisonnement qui imposait le tir nucléaire sans confirmation ni de l’objectif ni des circonstances était le produit, à l’époque, d’une procédure militaire pensée par un occident civilisé et démocratique. Que penser alors du processus de tir nucléaire en système soviétique ?
La gesticulation nucléaire est servie par des hommes, mais sa finalité destructrice et mortifère obéit à un système.
Impossible, pour un militaire responsable à son niveau d’un maillon de la chaîne conduisant à délivrer une arme nucléaire, de ne pas être confronté à sa propre réflexion et à celles des autres. Des penseurs comme Jean-Pierre Dupuy (Stanford), Gunther Anders, Barton Bernstein, Anna Arendt et d’autres, ont de façon concomitante avec les opératifs du nucléaire tenté de théoriser le processus qui conduit à déclencher le feu nucléaire. Dupuy insiste beaucoup sur les enseignements glaçants apportés par Mac Namara (ancien secrétaire à la Défense des Etats-Unis) dans sa réponse à la question qui lui a été posée de savoir pourquoi le conflit nucléaire n’a pas eu lieu pendant la guerre froide, sachant que l’on recense à ce jour un minimum de dix alertes qui auraient pu déclencher ce conflit. Oui, la réponse de Mac Namara a été « We lucked out » (traduction triviale : « Coup de bol »). Cette réponse fait appel au hasard heureux, donc à nouveau aux probabilités. Est-ce à dire que la possibilité du passage à l’acte de l’apocalypse nucléaire échappe à la raison, mais relève de l’irrationnel, du probable ? Hiroshima, Nagasaki, Truman, quitte ou double, pile ou face ? Le général Le May, chef de la compagnie des bombardements stratégiques dans le Pacifique, déclare en 1944 en commentaire du résultat du feu nucléaire américain : « Si nous avions perdu la guerre, nous aurions été jugés. » On est toujours dans le jeu de pile ou face ! La ‘’fortune morale’’ de cette campagne a été validée par le bon résultat (victoire américaine) d’un jeu binaire. Barton Bernstein, professeur à Stanford, déclare selon lui que la décision la plus importante de l’histoire moderne (Président Truman et l’arme nucléaire) n’aura même pas été une décision : la bombe était là, elle s’est imposée.
La puissance nucléaire gomme tous les calculs tactiques pratiqués dans la guerre classique. Elle s’impose comme le feu sacré de Zeus que Prométhée n’a eu de cesse que de dérober aux dieux, vol dont il paiera le prix instantanément dans une expiation cruelle. Gunther Anders, philosophe allemand, a des mots pour traduire cet état de soumission : « Parce que dépassés certains seuils, notre pouvoir de faire excède infiniment notre capacité de sentir et d’imaginer ».
Depuis le 24 février 2022, ce conflit sur terre européenne replace le feu nucléaire dans la réflexion de tout responsable.
Certes, il y a un relent de guerre froide, sauf à penser que cette fois le feu couve, avec ses farces et attrapes venimeuses, à la frontière même des deux camps, l’Occident et la Russie : le pire est possible. Dans ce contexte, usons de l’oxymore suivant : « La menace nucléaire est une réalité mais son embrasement est impossible. » Le premier mois de conflit justifie cet optimisme : mais ce dernier peut-il perdurer ?
Quelles sont en termes de puissance nucléaire l’état des forces en présence ? La Russie aurait quelque 6 000 têtes nucléaires, les USA 5 000, le Royaume-Uni 200 et la France 290. Il est clair que la supériorité nucléaire est du côté occidental. Mais aujourd’hui en logique de dégât possible nucléaire, le quantitatif a moins de valeur que le qualitatif : l’apocalypse peut être déclenchée par un seul tir dont la trajectoire échappe aux contre-mesures et atteint un objectif crucial (une capitale, par exemple).
Raisonnons russe
Les forces nucléaires sont en alerte (niveau 2) depuis plusieurs semaines aux fins de menacer l’Otan des conséquences d’une intervention directe dans le conflit. Pour ponctuer cette menace, les russes ont envoyé le 18 mars un missile véloce sur un dépôt de munitions et de carburant ukrainien qu’ils ont détruit. C’est aussi un message à deux volets : il faut noter que les russes disposent bien de la dernière génération de missiles (hyper véloces et peu vulnérables), d’autre part la proximité de l’impact de la frontière polonaise n’est pas non plus neutre. La menace se fait plus précise en cette seconde semaine d’avril, avec un appel-semonce en direction du gouvernement américain, formulé par le président russe annonçant des ‘’conséquences imprévisibles’’ si l’implication par la fourniture d’armes perdure : cette information indique l’augmentation régulière du degré d’adrénaline, sûrement lié à la perte du croiseur russe en mer d’Azov.
Certains analystes considèrent que l’aventure russe tourne au fiasco (pertes considérables, repli de l’armée, logistique défaillante…) et que le cessez-le-feu est proche, qui stabiliserait la frontière entre l’Ukraine et le Donbass sans accorder Marioupol aux russes.
D’autres analystes, à l’aune des revers subis par l’armée russe, des accusations d’atrocités russes contre la population civile, couplés aux terribles sanctions économiques, a pour effet immédiat d’antagoniser l’ensemble de cet immense pays jusqu’à rendre de plus en plus solidaire le peuple russe avec ses gouvernants. Vijay Maheshwan, journaliste et auteur américain vivant à Moscou, écrit ceci : « J’espère que Moscou va être ébranlé. Mais j’ai le sentiment qu’ils (les russes) vont plutôt endurer la souffrance et la peur et trouver un sens profond aux épreuves qui leur sont imposées. » Selon les paramètres énoncés de cette dernière analyse, le peuple russe acculé, humilié, est en train de faire corps avec ses dirigeants, faute d’autres ouvertures, attitude qui conforte le possible du pire et ce dans une longue tradition de l’âme slave. Le 14 septembre 1812, Napoléon arrivait avec la Grande Armée devant Moscou mais cette dernière capitale de la grande Russie était vidée de ses habitants et incendiée. Le Guardian appelle à la plus grande prudence avec un article de Pavel Podvig, spécialiste mondial des forces nucléaires russes : « Honnêtement, je suis inquiet ».
La Russie a officiellement une panoplie d’armes adaptées à différentes situations envisageables. C’est aussi le cas du nucléaire, car la Russie intègre dans ses moyens d’artillerie la frappe nucléaire tactique. Elle dispose de canons 287 Pion, tirant des obus de 203 mm jusqu’à une distance de 35 kilomètres. Ces obus peuvent être nucléaires et limités à un kilotonne, à savoir 20 fois moins puissants que la bombe d’Hiroshima. L’objectif désigné pour une telle arme destinée au champ de bataille peut être une concentration de troupes, une installation militaire, un aérodrome, voire permettre à une unité importante russe en difficulté de se dégager. Le coup porté par des missiles au croiseur Moksva, qui a provoqué sa perte, est d’une ampleur comparable aux dégâts d’un obus nucléaire d’un kilotonne. La Russie dispose aussi de missiles chargés entre 360 et 800 kilotonnes, ce qui est considérable et terrifiant. Le général d’Armée Marc Milley, chef d’Etat-major des Armées des Etats-Unis a déclaré que « la Russie est le seul pays au monde à avoir la capacité nucléaire capable de détruire les Etats-Unis. »
Imaginons un scénario « soft », probablement enregistré avec d’autres dans tous les dossiers secrets des Etats constituant l’Otan et particulièrement européens. Les armes, missiles, chars et canons promis par les occidentaux, par le premier ministre britannique en particulier, vont nécessairement stationner en Ukraine sur un lieu de rassemblement avant leur dispersion vers les zones d’engagement de l’armée ukrainienne. Le stockage sera nécessairement important et visible, du moins détectable dans une base choisie sûrement pas trop éloignée de la frontière. Cela devient alors une cible idéale et les conditions d’ingérence contre la Russie sont réunies pour un tir russe nucléaire tactique, dont les dégâts importants peuvent être limités pour la population civile.
Une concentration importante de troupes ukrainiennes en préparation d’une attaque sur un point sensible réunirait aussi tous les critères pour être éligible à une frappe nucléaire tactique.
Prévision, spéculation certes, mais si cela arrivait, quelle sera la réaction de l’Occident, et de l’Otan en particulier ? Seuls les Etats-Unis alors ont la capacité de réagir en frappant par exemple de manière limitée un établissement militaire russe. Le feraient–ils ? On peut estimer que non, sachant que le territoire étasunien n’est pas visé et que la frappe n’a pas touché un pays de l’Otan.
Poursuivons le scénario dantesque avec cette probabilité de non-intervention de l’Otan après un premier tir nucléaire tactique de la Russie. Une dégradation est possible en fonction de difficultés rencontrées pour l’Armée russe, dont elle rendrait responsable l’Occident par fourniture de matériels de guerre et armes. Si l’Occident est visé, deux pays européens hors Otan peuvent devenir des cibles de frappe tactique au prétexte de leur rôle de place tournante de fourniture de matériels à l’Ukraine : la Suède et la Finlande. Enfin, il ne faut pas exclure un tir classique sur une base polonaise accusée aussi de concentrer des matériels de guerre pour l’Ukraine. Face à cette théorie de scénarios, typiquement, dans l’espace européen, qui peut imaginer les Etats-Unis et l’Otan risquant leur propre destruction pour punir la Russie ? Les conséquences d’un premier tir nucléaire sur un champ de bataille seraient considérables pour l’avenir mondial des conflits. L’impuissance de l’Otan à sanctionner ce tir serait de nature à casser ce verrou nucléaire imposé par la guerre froide et l’Occident sur l’ensemble des théâtres de guerre. Un premier tir et ses conséquences apporteraient des arguments et paramètres, voire un permis à faire à des pays qui, eux, n’en ont pas fini avec la guerre, comme la Chine et l’Inde : possibilité d’embrasement à terme par mutualisation mondialisée de l’expérience russe. Il faut admettre qu’un tir nucléaire sur le sol européen dans ces conditions mettrait en première ligne réactive l’Europe elle-même et seule, malgré les gesticulations étasuniennes, donc le couple franco-anglais. La France et le Royaume-Uni ont abandonné le service d’engins tactiques, sachant que la mission de leurs forces nucléaires est fondamentalement d’ordre dissuasif.
Que ferait la France ?
La France a signé et ratifié le 2 octobre 2000 le statut de Rome de la Cour pénale internationale, statut qui réprime les violations des droits humains et du droit international humanitaire les plus graves et définit les crimes internationaux fondamentaux comme suit : « le génocide et les crimes contre l’humanité ». Cet engagement est très clair pour l’amiral François Jourdier : « La mise en œuvre de la dissuasion (concept français) dans le but de destruction de villes ou l’élimination de populations n’est pas conforme aux droits des conflits armés. »
Cette ratification du statut de Rome est incompatible avec une décision présidentielle de riposter selon le concept français de dissuasion à une attaque russe en Europe, voire en France.
Il est important de noter quel a été l’impact mondial de ce statut de Rome. On note que trente-deux états dont les USA et la Russie ont signé le statut de Rome mais ne l’ont pas ratifié : ces deux puissances de concert gardent donc toute leur liberté stratégique nucléaire. Intéressant aussi de noter que deux pays ne l’ont même pas signé ; la Chine et l’Inde. Cela signifie, in fine, que la France et le Royaume-Uni n’ont plus les armes légales selon les règles des conflits armés pour appliquer le concept original de dissuasion. Que la situation dégénère en Ukraine (elle se dégrade de jour en jour : perte du cuirassé !) jusqu’à ce que la Russie annonce avoir la preuve de l’implication directe de l’Otan contre son armée, affirmation ouvrant ainsi la voie au grattage d’une étincelle nucléaire d’une autre nature : la vitrification d’une ville européenne. Comme on l’a constaté, seuls les USA ont la possibilité et le droit légal d’intervenir en détruisant en représailles une ville russe, par exemple. Ce scénario n’est pas la guerre totale selon les doctrines diverses des pays ayant l’arme nucléaire, mais il peut être vraisemblable et sûrement envisagé. Sachant que dans le temps des représailles étasuniennes, une ville américaine serait elle-même vitrifiée, on peut facilement imaginer que les Etats-Unis ne prendraient pas ce risque ni celui de détruire la Russie qui déclencherait aussi l’apocalypse aux Etats-Unis.
Cette crise remet beaucoup de concepts, de postures et de graves problèmes éthiques en perspective. La réalité et l’actualité mettent en lumière le fait que la justification de l’équilibre par le nucléaire (guerre froide) est un très mauvais argument car ce processus prométhéen a pour compensation la négation de toutes les valeurs qui font l’humanisme. Il faut oser démontrer et affirmer que la foudre nucléaire n’est pas la guerre. Dans les faits, les gouvernances ont joué avec l’honneur des militaires en leur confiant le service de ces foudres qui ne nécessite ni intelligence, ni pensée morale, juste un servage, le servage d’un système. La logique du déclenchement du feu nucléaire peut être schématisée par une attitude et un objet ; une humeur et un bouton. Ce type de processus est dans les mains à ce jour d’un certain Kim Jong-un. A présent avec les enseignements de l’autopsie du processus nucléaire, aucun sentiment humain, aucune morale, aucune philosophie, aucune religion ne peuvent justifier et vouloir intégrer ce système dans le fonctionnement de l’Humanité. Danger il y a ! La seule espérance réside dans le fait que ce processus s’auto-invalide dans l’esprit des responsables.