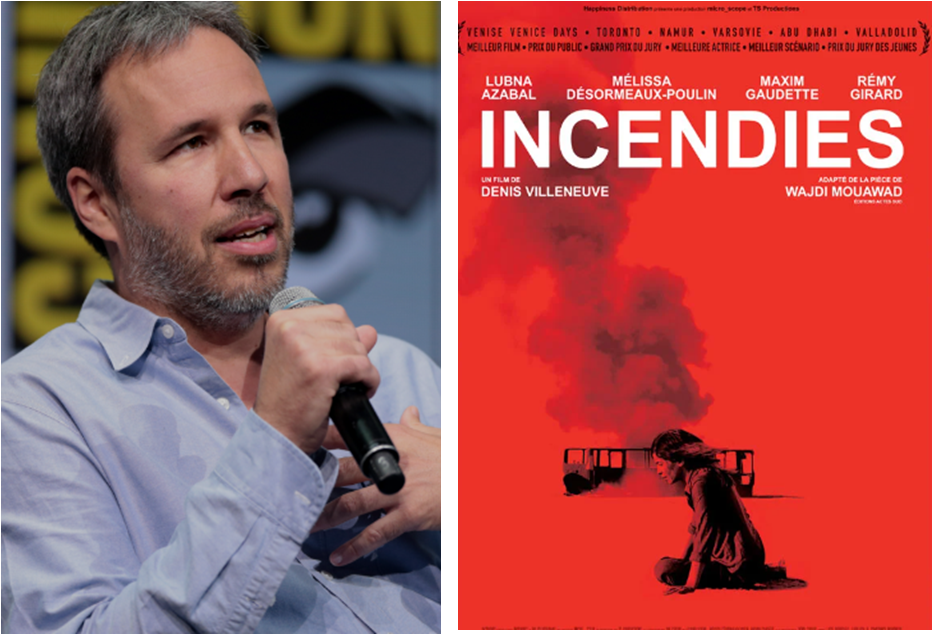par Michel Serres
Nous reprenons l’une des chroniques que Michel Serres a tenues tous les dimanches sur France Info de 2004 à 2018. Elles ont été intégralement éditées en 2021 par les éditions Le Pommier, dont l’aimable autorisation nous permet la publication ici.
« Le consensus » est la chronique du 17 janvier 2016. Les questions et interventions de Michel Polacco sont en italique.
*****
Cette semaine, le consensus. Voilà un mot que nous aimons : savoir, sans être d’accord, s’accorder et avancer ensemble. Je vous cite cette belle phrase de Lacordaire, reprise par Jean Guitton lors de son accueil à l’Académie française, dont vous êtes membre : « Je ne cherche pas à convaincre d’erreurs mon adversaire, mais à m’unir à lui dans une vérité plus haute ». J’aime beaucoup cette belle phrase. C’est l’apothéose du consensus, mais redescendons sur terre : le consensus est souvent le fruit de calculs, d’intérêts croisés, d’obligations. En politique, le consensus a du bon, mais il peut déboucher sur l’inaction, le ni-ni ou le plus petit dénominateur commun, ce qui n’est pas le mieux. Il y a le consensus mou, qui illustre ces situations où l’apaisement passe avant l’objectif même ou l’intérêt commun. On en a parlé lors des grandes réunions sur l’environnement ou lors des élections régionales, dans certaines circonstances. C’est aussi le cas pour les guerres justes que mènent les démocraties depuis quelques décennies. Alors, Michel, sommes-nous d’accord ?
Parfaitement d’accord. Il n’y a rien de plus démocratique et républicain que le consensus : la décision prise en commun, à la majorité des voix, après débat. Pas à l’unanimité, car elle est facteur de blocage. Mais le consensus, on peut en faire l’éloge en effet, puisqu’il fonde notre démocratie et notre liberté. Point final. Mais deuxièmement, je m’en méfie aussi pour une raison très simple : il n’y a rien de pire que l’entraînement de la foule ou de la communauté vers des idées ou des conduites communes. Le lynchage que décrit René Girard en est le meilleur exemple, et l’exemple le plus dangereux, ou le plus tragique, puisqu’il y a mort d’homme. Mais il y a aussi des choses plus légères, comme quelque chose d’aussi risible que de suivre aveuglément la mode, qu’elle soit vestimentaire ou cosmétique. C’est risible mais c’est aussi dangereux, dès le moment où la mode est idéologique. Ma jeunesse a trop vu de défilés enthousiastes, plein de consensus en effet, devant Hitler, Staline ou Mao, pour que je ne m’en méfie pas, plus ou moins. Par conséquent, c’est une bonne chose et une très mauvaise chose, un peu comme la langue d’Esope est la meilleure et le pire des choses. La langue d’Esope du collectif, tout simplement. A ce propos, je vais vous raconter une histoire, une très vieille histoire, une histoire qui date du début de la civilisation grecque : on raconte qu’un mort devait, lorsqu’il entrait aux Enfers, traverser un fleuve. Ce fleuve s’appelait le Léthé ; en grec, cela veut dire l’« oubli ». Cela signifiait que, quand vous traversiez ce fleuve et que vous étiez sur l’autre rive, vous étiez oublié. Et l’inverse du léthê, l’« oubli », était, en grec, aléthéia, la « vérité ». On raconte aussi que certains privilégiés, quand ils arrivaient sur l’autre rive, étaient rappelés sur la première rive du fait de leur gloire, de leurs exploits. Mais il fallait que sur la première rive, il y ait des poètes qui chantent leurs exploits, comme Homère raconte l’exploit d’Achille. Aléthéia signifiait donc la gloire. Nous y sommes. Aléthéia désignait celui qui est connu, celui qui réalise le consensus dans une collectivité. Et donc la vérité était synonyme de la gloire, la vérité était synonyme du consensus. On disait que la vérité avait à voir avec le nombre de gens qu’elle persuadait. Tout le monde lisait Homère et tout le monde était admiratif devant Achille. Et donc la vérité, c’était le consensus. A ce moment-là, les philosophes grecs sont arrivés, et pour eux, la vérité, ce n’était pas cela. C’était la démonstration, c’était l’expérience des choses qu’on peut voir ou démontrer, et, par conséquent, ils ont lutté toute leur vie pour imposer une nouvelle idée de la vérité, contre le consensus. Une phrase de Claudel, formidable, dit : « La vérité n’a rien à voir avec le nombre de gens qu’elle persuade ».
Bien sûr. On peut être seul et avoir raison alors que la foule a tort.
… contre tous.
Hélas !
Ah oui ! Mais aujourd’hui, où en sommes-nous ? C’est intéressant. Regardez par exemple la pratique des sondages. Les sondages vont-ils dire la vérité ? Par exemple, 60% des gens sont pour ceci, et 40% des gens, pour cela. De quoi parlent ces sondages ? Ils parlent de consensus ou, avec 60%, de majorité. Ce dont j’ai fait l’éloge pour la démocratie. Mais attendez, qu’est-ce que cette majorité ? Une majorité d’opinions, ce n’est pas la vérité. Par conséquent, aujourd’hui, entre la gloire, la gloire répandue par nous, par les médias, par les journalistes, par la télévision…, la gloire comme dans la vieille définition de la vérité, avec les Enfers – vous vous rappelez -, aussi bien qu’avec le sondage d’opinion, on est très près de la plus vieille idée du monde, selon laquelle la vérité a justement à voir avec le consensus. Ce n’est évidemment pas vrai. La plupart des inventeurs se sont même opposés au collectif de leurs collègues, même le collectif des savants… J’ai connu des inventeurs, les inventeurs de l’ADN, entourés de gens qui ne croyaient pas du tout à ces grosses molécules. Vous voyez la difficulté sur le consensus lorsqu’il s’agit d’inventions, d’innovation. Et cela ne concerne pas seulement les sciences, il y a un vieux texte, attribué à l’abbé Pierre, qui dit : « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir ; je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine ; je continuerai à construire, même si les autres détruisent ; je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre ». Par conséquent, le consensus, je le répète, est à la fois une bonne chose pour la gouvernance, pour la démocratie, la liberté, mais c’est aussi la pire des choses pour l’invention et l’innovation. C’est vraiment la langue d’Esope au niveau du collectif.
Merci Michel Serres.