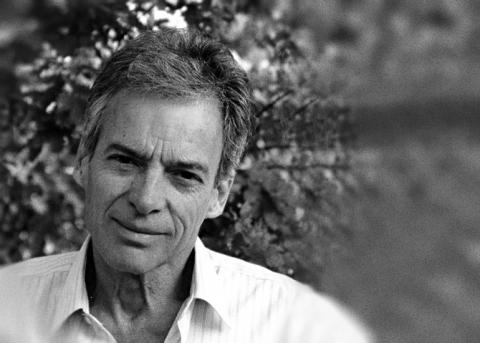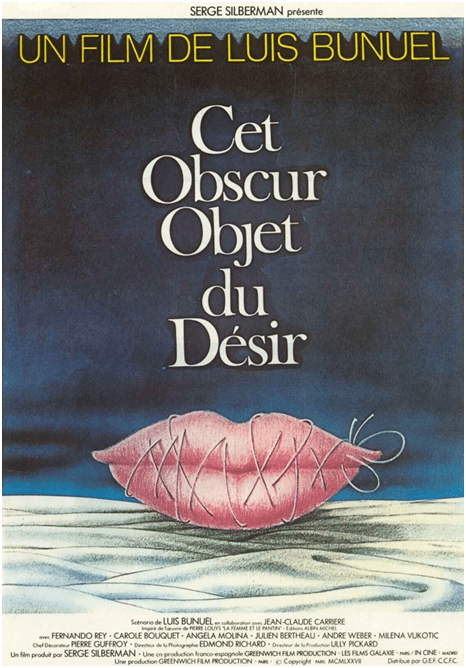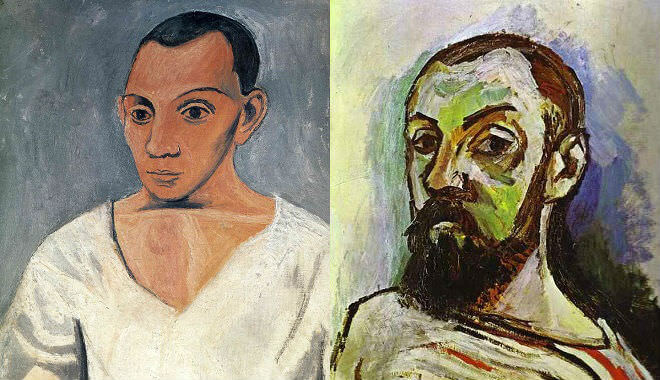A entendre les soi-disant « humoristes » de France Inter, nous autres « mangeurs de grenouilles » et régicides, sommes très loin de communier avec le Royaume-Uni, le Commonwealth et une partie de la planète dans la vénération de la couronne d’Angleterre et l’émotion suscitée par le décès d’une reine qui aurait porté cette couronne non seulement plus longtemps mais plus dignement qu’aucun de ses ancêtres. « Trop, c’est trop » entendons-nous au sujet de cette saga windsorienne : on peut suivre en temps réel à la télévision ou sur d’autres écrans la totalité des cérémonies consacrées à ce deuil planétaire ; et au cas où on aurait raté « the Queen », l’excellent film de Stephen Frears ou les nombreux épisodes de « The Crown » sur Netflix, des spécialistes de la monarchie anglaise et une foule de documentaires nous font savoir tout ce qui peut se savoir sur un règne hors-série.
Naturellement, il n’est pas besoin d’avoir lu Girard pour se rendre compte que le mépris des fastes royaux, l’ironie au sujet de traditions ancestrales, la condescendance des esprits éclairés à l’égard d’une émotion populaire indéniable, tout cela, qui contraste avec la couverture médiatique de l’événement, relève le plus souvent d’une posture idéologique plutôt que de sincères convictions républicaines. Les esprits forts sont en plein « mensonge romantique » ! Ce deuil royal intéresse tout le monde, c’est le cas de le dire et il faut se demander pourquoi.
Dans « Mensonge romantique… », René Girard écrit : « La révolution ne détruit qu’une chose, la plus importante bien qu’elle paraisse vide aux esprits vides : le droit divin des rois. Depuis la Restauration, les Louis, Charles et Philippe montent encore sur le trône ; ils s’y cramponnent, ils en descendent plus ou moins précipitamment ; seuls les sots prêtent attention à cette monotone gymnastique. La monarchie n’existe plus (…) La vraie puissance est ailleurs. Et ce faux roi qu’est Louis-Philippe joue en Bourse se faisant ainsi, déchéance suprême, le rival de ses propres sujets. » (1)
Il est vrai que la monarchie constitutionnelle anglaise ne donne pas au monarque le pouvoir de gouverner. On peut dire en effet, dans ce cas précis, que « la vraie puissance est ailleurs ». Mais s’il leur est arrivé d’être régicides, les Britanniques n’ont jamais désacralisé leur royauté. Leur chant national « God save the Queen » n’est pas comme le nôtre un chant guerrier révolutionnaire, mais un cantique (2). De la puissance du monarque, chef de l’Eglise anglicane et régnant sur le Royaume Uni et sur les pays du Commonwealth (56 pays, tout de même, dont le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande), on peut dire qu’elle est purement symbolique. Mais, comme dirait Girard, seuls les esprits vides peuvent croire vide de puissance le domaine du symbolique ! Dans les sociétés humaines, le symbolique non seulement fait partie du réel mais en commande l’interprétation et la représentation. Le réel est d’abord ce que nous nous représentons. La force (militaire, économique) est « sans dispute », dirait Pascal, c’est-à-dire qu’elle s’impose d’elle-même, mais elle reste inféodée au pouvoir politique ; or, le pouvoir politique ne peut exister comme tel et s’exercer que s’il parvient à s’incarner dans ses « représentants » : Montaigne fait état de l’étonnement scandalisé des « sauvages » venus (importés) d’Amérique devant la personne du roi de France, un enfant de 10 ans.
Elizabeth II aura été, de l’avis général, une représentante parfaite de la monarchie britannique, on n’aura jamais fini de décliner les qualités qui ont fait d’elle une servante au service de son peuple et de sa glorieuse histoire. Son influence personnelle sur la marche de certains événements est avérée. Mais il me semble qu’on ne peut comprendre l’émotion suscitée par son départ définitif de la scène publique en se référant à sa seule personne et aux péripéties de sa propre histoire, comme on se complaît toujours à le faire. J’ai été frappée du fait que les médias et les « spécialistes » de la cour d’Angleterre, en même temps qu’ils nous abreuvaient d’images et de récits, constataient que la reine défunte emportait son secret dans sa tombe et que personne, dans son entourage proche, peut-être même pas elle-même, ne pouvait se vanter de la connaître. Elle s’était totalement forgée et fondue dans son statut et son rôle de monarque.
« La reine est morte, vive le roi ». La personnalité du souverain n’a jamais été négligeable, même pas de nos jours dans des démocraties qui ne lui confèrent que ce pouvoir symbolique de « représentation ». Mais l’essentiel est dans ce que Girard désigne comme la « médiation externe ». Les rois ne sont pas à proprement parler des modèles ; mais ils incarnent une transcendance, une « identité » incontestable dans un monde « globalisé » où les peuples comme les individus sont en quête d’identité. L’idée ne serait venue à personne d’imiter Elizabeth II, même quand elle apparaissait en foulard et en bottes, en balade avec ses chiens dans la lande écossaise. Et il ne serait venu à l’esprit de personne de la voir, dans cet accoutrement, en train d’imiter ses sujets. Elle ne s’est jamais comportée en rivale de ses sujets, même dans ses affaires de famille. Son identité était dans l’incarnation et la vénération d’une histoire, celle du Royaume Uni. Et son statut de reine couronnée (sacralisée) lui conférait ce pouvoir extraordinaire de représenter ici et maintenant des siècles de civilisation : une civilisation pleine de bruit et de fureur, comme toutes les autres mais une civilisation « modèle » qui a donné au monde le théâtre de Shakespeare etc., et finalement un style britannique, fait de multiples singularités, dans lequel se reconnaissent la plupart de ses sujets et que le monde entier leur reconnaît.
Dans une émission récente de « Répliques », sur France-Culture, Alain Finkielkraut cite Ortega y Gasset, qui écrit dans « La révolte des masses » à propos de la monarchie britannique et de sa fonction de « symboliser », en particulier par le rite du couronnement : « L’Anglais tient à nous faire constater que son passé, précisément parce qu’il est passé et qu’il en est libéré, continue d’exister pour lui. Ce peuple circule dans tout son temps, il est véritablement seigneur de ces siècles dont il conserve l’active possession. » Cette force que constitue pour un peuple le fait de pouvoir circuler dans tout son temps n’est-elle pas, pour lui, à l’heure de la mondialisation, vitale ?
Il est sans doute moins facile pour les Français de circuler dans leur histoire en se l’appropriant complètement. Je pense à ces deux catégories de Français distinguées par Marc Bloch en 1940, et qui selon lui, ne comprendront jamais l’histoire de France : ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération ; comment vibrer à la fois pour la sacralisation du roi et pour la souveraineté du peuple ? Pour circuler dans tout leur temps, il faudrait que les citoyens français ne soient pas divisés entre eux et en eux-mêmes entre deux nostalgies incompatibles, la nostalgie monarchique et la nostalgie révolutionnaire.
En retraçant une histoire du désir dans les temps modernes, de Cervantès à Proust, Girard a aussi montré l’irréversibilité du temps : sous l’effet de la mimésis, moteur de l’histoire, le passage d’une société hiérarchisée, aristocratique à une société égalitaire, démocratique, est à la fois inévitable et irréversible ; on ne revient pas en arrière, la médiation externe, la vénération à l’égard de modèles inaccessibles a été remplacée par la médiation interne, l’imitation du semblable, puis la médiation double, c’est-à-dire la concurrence de tous. « La médiation double est un creuset où se fondent lentement les différences entre les classes et les individus. »
La monarchie britannique, la seule en Europe, par le rite du couronnement, à sacraliser son monarque, a conservé un certain sens de la hiérarchie héréditaire, soit une verticalité, une transcendance au sein d’une véritable démocratie, multiculturelle en raison du passé colonial. Cette transcendance qui plonge ses racines dans le temps historique, est de l’ordre d’un temps « immémorial », elle ne donne pas seulement l’épaisseur de la durée à un Etat moderne, elle lui confère une vocation. Les sujets de Sa Majesté n’ont pas à choisir leur identité, ce « moi » ou ce « nous » qu’il faut affronter aux autres, ils la reçoivent sous la forme d’une singularité qui s’affiche dans des détails, une façon de parler hésitante, « l’understatement », un style vestimentaire : la reine ne porte pas toujours sa couronne mais des chapeaux invraisemblables ; assortis à des tailleurs de la même couleur criarde que leur fameuse « jelly », ils symbolisent cette singularité ; on ne se demande pas si c’est de bon ou de mauvais goût, il s’agit d’une inimitable différence. Rien d’étonnant que les excentricités et les innovations, par exemple la minijupe, soient également une spécificité anglaise.
Girard a montré que l’autonomie est un leurre. « Ni Dieu ni maître », cette belle formule est entachée de suspicion. Tocqueville avoue, dans un passage de La Démocratie en Amérique que j’ai gardé en mémoire, ne pas croire à la possibilité pour l’homme de jouir d’une entière liberté ; c’est pourquoi, écrit-il : « s’il est athée, il faut qu’il serve et s’il est libre, il faut qu’il croie. » L’autonomie est cependant un concept irrécusable pour penser la démocratie ; le tort de l’individu moderne est sans doute d’avoir rendu l’autonomie incompatible avec l’hétéronomie. Pourtant, l’idée selon laquelle on doit recevoir de l’extérieur les moyens de se construire et de se définir n’est-elle pas une idée de bon sens ? L’acceptation de la verticalité (la médiation externe) est le seul moyen d’éviter les affres de la « transcendance déviée », c’est-à-dire l’idolâtrie, si bien analysée par Girard. En effet, ce désir légitime d’« être soi-même » dans un monde concurrentiel serait mieux protégé des affres de l’envie, de la jalousie et de la haine impuissante (3) s’il était à l’abri de quelque chose qui nous transcende et nous permet de nous rattacher à nous-mêmes ; c’est ce « quelque chose » qui s’est incarné, y compris pour le Commonwealth, dans une reine, pendant le règne d’Elizabeth II.
Pour enfoncer le clou, je pense à l’autre événement historique que constitue le nouveau gouvernement de Sa Majesté, présidé par Liz Truss. Les postes-clés y sont confiés à des personnes que nous dirions issues de la « diversité » ; c’est une représentation de la société multiculturelle britannique au plus haut niveau de l’Etat dans un cabinet plus que droitier ; événement remarquable, auquel il faut ajouter ces sondages édifiants : 53% des Britanniques estiment que l’immigration est une bonne chose et 70% que la diversité est bénéfique. On peut se poser la question : comment se fait-il que la colonisation anglaise, qui fut d’une grande violence, n’ait pas creusé entre les pays ex-colonisés et la nation ex-impériale ce fossé de haine et de rejet tel qu’on le voit ailleurs, par exemple chez nous ?
Proposons, pour conclure, un élément de réponse girardienne : la colonisation française, malgré sa violence indéniable, a été « universaliste », elle a préféré l’assimilation au séparatisme ou au régime d’apartheid. Elle a voulu effacer les différences plutôt que de les reconnaître et de les pérenniser. « Nos ancêtres les Gaulois » ont été imposés à tous les écoliers, quelle qu’ait été la réalité de leur passé. Le résultat a été que le ressentiment du colonisé s’est porté sur ce « creuset » où devaient se fondre les différences entre les peuples : ils ont haï l’universalité comme symbole de la violence indifférenciatrice de l’impérialisme occidental.
La monarchie britannique n’est pas « universaliste ». Elle a été impérialiste, elle a constitué un Empire. Et le Commonwealth, composé de nations devenues indépendantes et libres d’y adhérer, pleure aujourd’hui sincèrement SA souveraine. Vue sous l’angle de la théorie mimétique, cette réussite pourrait s’expliquer ainsi : une haine impuissante, celle de la médiation interne, répand sur les âmes un poison mortifère parce qu’on ne peut haïr l’autre sans ressentiment à l’égard de soi-même ; or, il semble que les sujets de la Couronne aient réussi à éviter cet écueil et même à tirer avantage de leur servitude comme de leur indépendance en insufflant à leur haine ce qu’il faut voir comme de la vénération, en tous cas une forte dose d’admiration qui a fait barrage au ressentiment, c’est-à-dire à la haine de soi.
*****
Notes :
1) Mensonge romantique et Vérité romanesque, chapitre V « Le Rouge et le noir »
2) Comme la Marseillaise, l’hymne anglais est d’origine française. Composé pour demander à Dieu la guérison de Louis XIV, en 1686, par une dame de la cour, la duchesse de Brinon, pour les paroles et Lully pour la musique.
3) Stendhal dans les Mémoires d’un touriste.