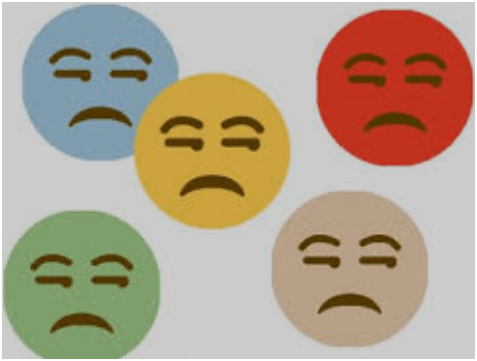par Jean-Louis Salasc
Après deux ans de guerre en Ukraine, c’est l’échelle des morts et des estropiés, civils ou militaires, ukrainiens ou russes.
*****
Un million de vies brisées, alors que les vainqueurs et les vaincus sont connus depuis longtemps.
Au chapitre des vainqueurs, médaillés d’or, les dirigeants chinois.
La Fédération de Russie n’a plus d’autre choix que de se tourner vers la Chine, pour vendre son gaz, trouver une alternative au système de paiements internationaux et obtenir un (discret) soutien à son effort de guerre. Les dirigeants chinois vont mettre la main sur les immenses ressources du sous-sol russe, à des conditions plus que favorables. Accessoirement, la guerre d’Ukraine allège la pression que leur grands concurrent, les dirigeants des Etats-Unis, exercent sur eux. Enfin, elle procure aux dirigeants chinois une posture avantageuse aux yeux du Sud global ; un envoyé du gouvernement chinois entame actuellement une tournée d’évaluation et se présente comme recours pour la paix. Tout cela sans voir donné le moindre coup de fusil ; les mânes de Sun Tzu sont dûment honorées : « Détruire l’adversaire n’est qu’un pis-aller ; la meilleure stratégie est de s’emparer de lui sans avoir à combattre ».
La médaille d’argent revient aux dirigeants des Etats-Unis.
L’OTAN, qu’ils contrôlent, naguère en état de « mort cérébrale », vient de s’élargir encore, avec la perspective de nouvelles bases militaires en Suède et en Finlande. Les commandes à l’industrie américaine de l’armement connaissent et vont connaître un remarquable essor. Conséquence du sabotage des gazoducs sous-marins de Nord Stream, les Etats-Unis remplacent la Russie comme fournisseur de gaz à l’Europe. Enfin, en contrepartie de son aide à l’Ukraine, des compagnies américaines ont obtenu les futurs contrats de reconstruction du pays, et ont acquis, en particulier les fonds Black Rock et Vanguard, une grande partie des terres cultivables d’Ukraine. Un bémol cependant : l’exclusion de la Russie du système SWIFT des paiements internationaux ouvre la porte à des transactions hors dollar, ce qui menace son statut de monnaie de réserve mondiale.
Voici maintenant les vaincus ; peu importe ici le classement.
Les dirigeants russes sont embourbés dans un conflit qu’ils ne parviennent pas à maîtriser. Le pays perd des hommes alors que la démographie est l’un de ses points faibles. Les dirigeants russes se sont aliénés la population ukrainienne, qui était à 73% favorable à une entente avec la Russie en 2019 (résultat de Volodymyr Zelenski à l’élection présidentielle, sur la promesse de campagne de faire la paix avec Moscou). L’OTAN s’est agrandie ; la Fédération de Russie ne bénéficie plus de la neutralité de la Suède et ni surtout de la Finlande, avec qui elle partage une frontière de 1 300 kilomètres. Plus généralement, toute perspective de voisinage pacifique avec l’Europe est désormais exclue pour des décennies. Les pays européens ne sont plus clients de l’énergie russe, c’est une perte majeure. Enfin, la position géopolitique à long terme de la Fédération de Russie est compromise : nous l’avons vu, elle est désormais à la merci des dirigeants chinois, indépendamment des manifestations d’amitié respectives. Même si l’armée russe parvenait à s’emparer de la totalité de l’Ukraine (en deux ans de combats, elle n’est toujours pas arrivée à franchir le Dniepr), cela ne changerait rien à ce bilan ; cela l’alourdirait même que d’avoir à occuper un pays hostile.
L’Ukraine est dévastée. Une partie de la population a quitté le pays, et les pertes humaines sont terribles. Le simple fonctionnement de l’Etat ukrainien dépend intégralement des subsides apportés par les dirigeants des pays occidentaux. L’une des grandes ressources de l’Ukraine, la production agricole, est hypothéquée (cf. ci-dessus). Les forces armées ukrainiennes tiennent tête à celles de la Russie, mais les dirigeants ukrainiens ont un problème avec les buts de guerre, car les leurs (récupérer les territoires de 1991) ne coïncident pas avec les objectifs des pays qui les soutiennent. Par exemple, les dirigeants des Etats-Unis cherchent avant tout à affaiblir la Russie, ainsi qu’en témoigne un rapport publié en 2019 par un cabinet conseil du Pentagone (1). Même si l’armée ukrainienne parvenait à reprendre le Donbass et la Crimée, le pays et ses dirigeants se retrouverait dans la situation de vassal des dirigeants occidentaux. Il est vrai que beaucoup acceptent et même savourent ce statut, les dirigeants américains étant tous, nous le savons bien, des philanthropes désintéressés, attentifs et délicats à l’égard de leurs obligés.
Les pays européens sont également à inscrire dans la liste des vaincus. La menace russe les assujettit encore davantage à l’OTAN et aux dirigeants des Etats-Unis ; n’oublions jamais la phrase de Zbigniew Brzezinski, ex-secrétaire d’état, dans son ouvrage « Le grand Echiquier » en 1993 : « L’Europe de l’Ouest reste dans une large mesure un protectorat américain et ses Etats rappellent ce qu’étaient jadis les vassaux et les tributaires des anciens empires ». Les pays européens se retrouvent dorénavant en antagonisme aigu avec leur plus grand voisin. Le gaz russe, géographiquement proche donc meilleur marché, est désormais inaccessible ; l’industrie allemande en est particulièrement pénalisée. Le soutien à l’Ukraine coûte et coûtera cher, quel que soit l’issue des combats sur le terrain.
Un million de vies brisées, mais l’escalade continue.
Le panorama précédent pourrait suggérer que le conflit s’éteigne : les vainqueurs ont pris leurs gains et les vaincus n’ont plus guère de perspectives d’améliorer leur bilan structurel.
Ce serait oublier les lois de la rivalité mimétique, qu’a dévoilées l’anthropologie de René Girard. Je me proposais de mener une « analyse » girardienne de ce conflit, mais le schéma de montée aux extrêmes crève tellement les yeux que le terme « analyse » est largement surdimensionné.
Notons simplement quelques points caractéristiques. Comme entre autres le mécanisme d’accusation réciproque, que nous avons tous pratiqué dès la cour de la petite école : « C’est pas moi qui ai commencé, c’est lui ». Les protagonistes semblent tous avoir bien du mal à se déprendre de son emploi : « C’est Poutine l’agresseur », « C’est l’OTAN qui s’est avancé vers l’est », etc.
Autre trait caractéristique, que Girard a mis en évidence dans les spirales de réciprocité violentes : l’oubli de l’objet initial ; ici des cousins germains, dirigeants ukrainiens et dirigeants russes, qui se disputent un petit territoire. Mais cet objet a disparu derrière les fantasmes des dirigeants des pays entrés dans la boucle. « Poutine ne doit pas gagner », « Cette opération est existentielle pour la Russie », « Il faut sauver la démocratie », « L’OTAN ne doit pas perdre sinon elle s’effondrera », « Il faut mettre fin à l’hégémonie unipolaire de l’Occident », etc.
A part quelques personnalités signalées dans un précédent article (2), aucun dirigeant, ni occidental ni russe, ne propose d’explorer la voie diplomatique. Au contraire, « petites phrases » et « tweets » alignent les menaces comme à la parade. Une position apparemment plus raisonnable s’affiche parfois : « Oui à la négociation, mais il faut d’abord améliorer notre position ». C’est-à-dire continuer la guerre et faire s’entretuer nos soldats : ce serait un oxymore savoureux s’il ne faisait référence à une sinistre réalité.
Un million de vies brisées et que faisons-nous ?
Nos dirigeants ont envoyé en Ukraine des canons Caesar et des missiles SCALP, qui ont tué. Ces armes sont financées par nos impôts : nous avons du sang sur les mains. Nous n’avons pas même la justification, si c’en est une, qu’il s’agissait d’ennemis : nous nous entendons sans cesse répéter que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
Récemment, le président de la République a émis l’idée que les pays de l’OTAN pourraient envoyer des troupes combattre en Ukraine. Un tollé s’ensuit : de Jan Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, à Joe Biden, tous condamnent le propos.
Mais une petite musique commence à s’élever. D’abord par quelques « experts » qui, dans divers médias, donnent raison au président de la République ; ils sont bientôt rejoints par des politiciens, comme Jean-Pierre Raffarin. Puis, la perspective est clairement soutenue par les dirigeants de divers pays, la République tchèque, la Lituanie, la Pologne…
Depuis deux ans, le discours dominant consistait essentiellement à désigner Vladimir Poutine comme source unique du conflit et à décrire la menace, de caractère très général, qu’il fait peser sur à peu près tout. Et voilà que surgit, une dizaine de jours après les propos « polémiques » du président, une nouvelle thématique : ceux qui refuseraient d’envoyer des troupes en Ukraine sont des lâches, dit-il au cours de sa visite en République tchèque. Par un étonnant hasard, le magazine « Le Point » propose la même semaine comme page de couverture : « Ces Français au service de Moscou ». Après la désignation de l’ennemi et sa diabolisation, voici donc maintenant la phase de dénonciation des « traîtres » à l’intérieur de la communauté.
Et une semaine plus tard, un vote, non contraignant vous l’avez noté, permet à l’Assemblée nationale de cautionner a posteriori les livraisons d’armes depuis deux ans et l’accord de défense franco-ukrainien que le président de la République avait passé de façon discrétionnaire le mois précédent.
De cette séquence, beaucoup d’interprétations ont été données : dérapage, erreur, manœuvre politique, gestion de l’actualité, jeu de rôle, prise de leadership européen, etc.
Sauf une.
Sauf la lecture girardienne selon laquelle un « médiateur » serait à l’œuvre pour instiller dans notre communauté nationale, sinon à l’échelle de l’OTAN, le désir de guerre contre la Russie. Il n’y a pas de désir sans médiateur, nous enseigne Girard. Alors, dans le cas présent, de qui s’agit-il ?
Le désir de guerre est toujours porté par un petit club. Il trouve ses membres parmi cinq cercles : les dirigeants politiques, les marchands d’armes, la haute hiérarchie militaire, les journalistes et les financiers.
C’est un club restreint, mais les guerres sont collectives, elles engagent toute la communauté ; comme disait Henri Jeanson : « La guerre, le seul plaisir des princes dont les peuples aient leur part ». Le petit club se trouve donc à devoir jouer les « médiateurs ».
Il s’avère que cette activité s’est professionnalisée, et même industrialisée, au fil des siècles. Son vecteur est la propagande. Propagande ! Quel un gros mot ! Bien sûr, seuls nos adversaires en sont coupables ; nos démocraties, vous le pensez bien, ne mangent pas de ce pain-là.
En 1916, Woodrow Wilson est candidat à sa propre réélection ; il mène campagne sur le maintien les Etats-Unis à l’écart du conflit en Europe, position disposant d’une écrasante majorité dans l’opinion publique américaine. Tout juste réélu, Woodrow Wilson est saisi d’une soudaine inspiration messianique et fait entrer les Etats-Unis en guerre le 6 avril 1917 ; dix jours plus tard, il met en place la Commission Creel, afin de convaincre l’opinion du bien-fondé de sa volte-face, de trouver des volontaires et de mobiliser l’épargne des américains (ce seront les célèbres « Liberty Bonds »). L’un des membres de cette commission était Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud et futur pape de l’industrie publicitaire américaine. Quelques années plus tard, en 1925, il s’émerveillera du succès de la commission Creel et détaillera ses actions et opérations par le menu. Dans un livre qui s’intitule Propaganda.
*****
(1) Rand Corporation, 2019, « Overextanding and unbalancing Russia” (disponible sur le net)
(2) Lien : https://emissaire.blog/2023/03/14/ukraine-deuxieme-annee/