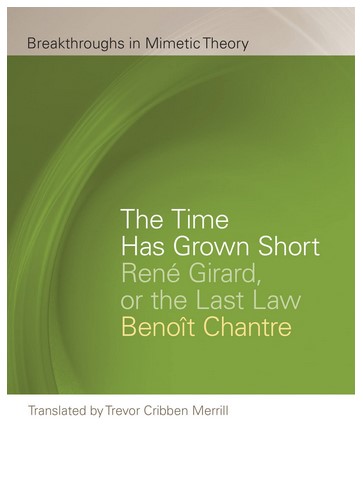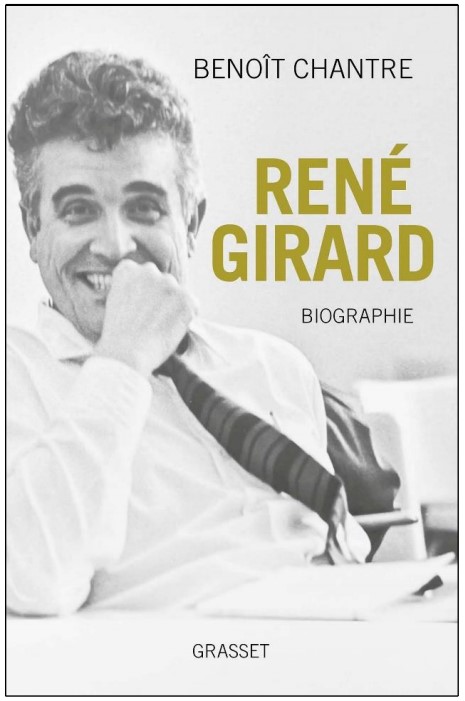par Hervé van Baren
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d’une série de conférences intitulées Bible et Violence. Soutenues par l’Association Recherches Mimétiques et l’association « Sortir de la Violence », elles seront animées par Hervé van Baren, formateur de NOVA et chroniqueur sur le blog Emissaire. Au fil de la Bible, nous découvrirons ainsi une interprétation nouvelle, inspirée de la pensée de René Girard : une lecture qui démythifie la violence présente dans les Ecritures et nous permet de contempler le Dieu d’Amour. « En Lui, pas d’obscurité » (1 Jean 1, 5).
Laissons Hervé présenter ce cycle de conférences (les informations pratiques sont données au bas du présent billet) :
Une présentation plus détaillée :
« J’ai interrogé ChatGPT sur la Bible. Voici quelques extraits de nos conversations.
Question : Parle-moi de la Bible
ChatGPT : […] La Bible a eu une énorme influence sur l’histoire, la culture, la littérature et la pensée occidentales. Elle a inspiré des artistes, des philosophes et des dirigeants politiques à travers les siècles. Les interprétations de la Bible varient en fonction des croyances et des traditions religieuses. Différentes dénominations chrétiennes peuvent accorder plus d’importance à certaines parties de la Bible que d’autres, et les interprétations théologiques peuvent varier considérablement.
Question : La Bible est-elle encore pertinente aujourd’hui ?
ChatGPT : Oui, la Bible reste pertinente pour de nombreuses personnes et pour plusieurs raisons, même à l’époque actuelle.[…]
Il est important de noter que la pertinence de la Bible peut varier en fonction des croyances, des cultures et des perspectives individuelles. Pour certaines personnes, la Bible reste une source inestimable de guidance spirituelle et morale, tandis que d’autres peuvent l’aborder d’un point de vue plus historique, littéraire ou culturel.
Question : La Bible est-elle une révélation anthropologique ?
ChatGPT : […] En fin de compte, la perception de la Bible en tant que révélation anthropologique dépend des convictions personnelles, religieuses et académiques de chaque individu. Certaines personnes considèrent la Bible comme un document de révélation divine, tandis que d’autres se concentrent sur son importance en tant que témoin de la culture, de l’histoire et de la pensée humaine.
En résumé, ChatGPT manie avec brio le politiquement correct et sa congénitale hypocrisie. Toutes mes questions déclenchent immanquablement un avertissement qui vise à disculper notre IA à la fois de toute apologétique et de tout sentiment anti-religieux. Ni pour ni contre, bien au contraire. Pourtant, sa prudence n’arrive pas à cacher l’idée générale qui se dégage de ses réponses, idée parfaitement en phase avec la pensée dominante du temps. La valeur de la Bible dépendrait entièrement du point de vue subjectif du lecteur ou de la lectrice. On ne saurait résumer mieux la perception du religieux, ces jours-ci, dans les sociétés sécularisées. C’est d’ailleurs plus généralement une image du relativisme ambiant, seulement perturbé par quelques activistes du genre « woke » ou antispécistes (dont on dit d’ailleurs assez qu’ils appartiennent au domaine du religieux).
Ce constat permet de mieux mesurer la bombe intellectuelle que représente l’approche de René Girard. Prétendre que la Bible détient une connaissance unique et universelle sur l’humain, voilà qui est résolument à contre-courant de l’époque. En définitive, le crime impardonnable de Girard est d’avoir réintroduit l’absolu dans l’équation – l’absolu d’un savoir inaccessible à la raison humaine, du moins sans révélation, sans écho d’une transcendance qui se situe au-delà de notre aveuglement mimétique. Pas étonnant dès lors que les philosophes et la faculté n’aiment pas Girard : eux ont conclu, après moult et savantes réflexions, à l’inexistence de toute forme d’absolu, pire encore, à la nature toxique de toute forme d’absolu. Et je ne parle même pas de transcendance.
Derrière les précautions oratoires du robot se cache la conviction, largement répandue sous nos cieux, que le fait religieux n’est rien d’autre que de l’obscurantisme, de la pensée magique. Il est temps de grandir, le père Noël n’existe pas. Il faut commencer par écouter les sceptiques. La violence affichée dans la Bible est intolérable. Elle l’est avant tout parce que la violence est intolérable. Elle l’est d’autant plus que les croyants des religions monothéistes professent leur foi en un Dieu fondamentalement bienveillant, un Dieu qui nous veut du bien. Il faut avoir le courage de le reconnaître, il y a là une incompatibilité de fond.
Cependant, ceux-là même qui s’enorgueillissent de leur capacité à déconstruire le monde apparent pour en révéler les structures invisibles se heurtent au scandale de cette violence sacrée sans jamais le dépasser. Le sacré, semble-t-il, aveugle autant celles et ceux qui vivent sous son règne que celles et ceux qui prétendent s’en être affranchis.
Je suis attristé par la capitulation des religions devant le nihilisme ambiant (à l’exception de leurs branches fondamentalistes, qui se contentent d’obstinément nier la pertinence des découvertes scientifiques et des avancées humanistes). Admettons que cette capitulation a des excuses. Voilà plusieurs siècles que la pensée profane ébranle les fondations de leurs dogmes à coups de découvertes scientifiques, de dévoilement des structures violentes du monde, de compréhension toujours plus pointue de l’humain. En la matière, Girard n’est pas en reste. Que subsiste-t-il de nos temples sacrés lorsque nous apprenons qu’ils servent surtout à perpétuer l’ordre sacrificiel ? Les Lumières et les courants ultérieurs ont si bien fait leur travail que le christianisme a fini par adopter le langage du monde. L’exégèse biblique, en particulier, est devenue une annexe de la faculté, avec pour seule particularité de continuer à défendre faiblement une part révélée des textes sacrés.
Mais lorsqu’il s’agit des passages les plus dérangeants, il n’y a plus personne. Ce sont des relents du monde barbare d’antan, des ajouts tardifs, des mauvaises traductions. Il faut, pour éviter le scandale, « replacer dans son contexte ». Or ce contexte culturel, historique, n’est pour les auteurs de la Bible qu’un cache-misère destiné à nous épargner la vision insupportable de la violence qu’ils exposent, universelle, intemporelle, invincible. En adoptant depuis quelques siècles une posture défensive, l’exégèse et la théologie s’épargnent l’épreuve d’une profonde remise en question du sacré, la confrontation avec la dimension subversive des textes.
Il y a peu de courants exégétiques en dehors de celui inspiré par la réflexion de René Girard, qui osent se confronter à cet aspect des textes. Le récent colloque du COV&R (1) m’a permis de vivre toute la fécondité et l’exception de ce courant, mais aussi de constater à quel point il reste marginal de ce côté-ci de l’Atlantique.
Lors de ce colloque, le philosophe Vincent Delecroix commentait un passage de l’Evangile selon St Matthieu :
Alors Pierre s’approcha et lui dit : « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. (Mt 18, 21-22)
La surenchère de Jésus peut bien entendu s’entendre comme une incitation à entrer dans une autre dimension du pardon, une bienveillance de fond qui anime notre vie en toutes circonstances. Cependant, le regard girardien permet le retournement du sens du texte. Les propos de Jésus soulignent le caractère excessif de la vengeance, puisqu’il faut ce nombre déraisonnable de tentatives de pardon. J’ajouterais que nous avons dans le texte une indication de la responsabilité du « pardonneur » dans l’échec de sa démarche. C’est toujours l’Autre qui commet des fautes à notre égard, jamais l’inverse. Pour que Pierre n’ait à pardonner qu’une seule fois, il lui manque l’introspection, la révélation de sa part de violence dans la genèse du conflit, autrement dit la révélation très girardienne de la réciprocité de la violence. Tant qu’il se considérera innocent et victime, son pardon ne sera pas sincère et surtout, il restera sans réponse. Seule la reconnaissance de sa responsabilité propre peut ouvrir un espace de pardon véritable, chez lui comme chez son frère. On trouve d’ailleurs le même indice d’une démarche de réconciliation inaccomplie dans le Sermon sur la Montagne :
Quand donc tu vas présenter ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; viens alors présenter ton offrande. (Mt 5, 23-24)
Le texte fait une allusion discrète à la mémoire sélective qui occulte notre part de violence. Il nous incite à la réflexion par une provocation. Quand nous voulons bien dépasser la lecture sacrée, nous sommes choqués par l’encouragement à prendre l’initiative de la réconciliation, alors que nous nous voyons parfaitement innocent. N’est-ce pas à mon frère de faire le premier pas, puisque le ressentiment lui appartient ?
On notera dans ces deux exemples une caractéristique générale de ce que j’appelle le retournement parabolique. La lecture traditionnelle met toujours l’accent sur le caractère légaliste, moralisateur des propos de Jésus. Il faut pardonner, quoi qu’il en coûte. La parabole nous fait basculer dans une autre dimension : la révélation, sans jugement moral, des mécanismes inconscients et mimétiques qui permettent à la violence de maintenir son indétrônable pouvoir.
Pour remédier à mon humble niveau à la regrettable carence de cette interprétation des Ecritures dans le monde francophone, j’organise une série de conférences mensuelles, qui auront lieu en présentiel à Bruxelles, et par Zoom(1). Mon approche est très simple. Expulser les textes qui nous dérangent pour ne garder que la face lumineuse revient strictement à mettre en cause le caractère révélé des Ecritures. Les passages violents ou choquants, au contraire, sont aussi les plus révélateurs, du moins si on accepte l’idée que la Bible garde en réserve la part sombre de la révélation, la vérité sur notre violence. La méthode permettant de basculer de la lecture sacrée, qui plébiscite ou à tout le moins excuse cette violence, à la lecture sainte, qui la réprouve et la rejette, passe par la reconnaissance d’une forme littéraire particulière : la parabole. Nous lirons donc les textes comme des paraboles. » (Hervé van Baren)
(1) Colloquium on Violence & Religion, colloque organisé à Paris du 14 au 17 juin dernier, à l’occasion du centenaire de la naissance de René Girard.
******
Informations pratiques :
| Quand ? Chaque premier lundi du mois. Première lundi 9 octobre 2023 de 19 à 21 heures. Comment ? En vous inscrivant via le lien ci-dessous : https://www.eventbrite.com/cc/conferences-bible-et-violence-2443579 |
| Où ? En présentiel à la Faculté Universitaire de Théologie Protestante, 40 rue des Bollandistes 40, Bruxelles (Etterbeek), ou par Zoom. À quel prix ? Gratuit. |