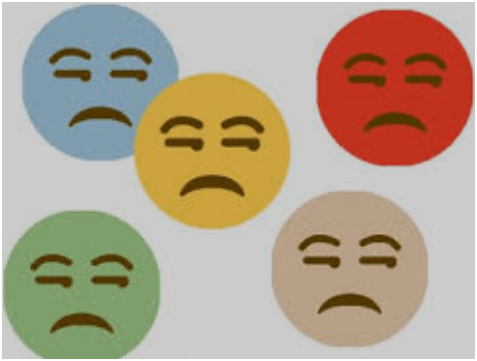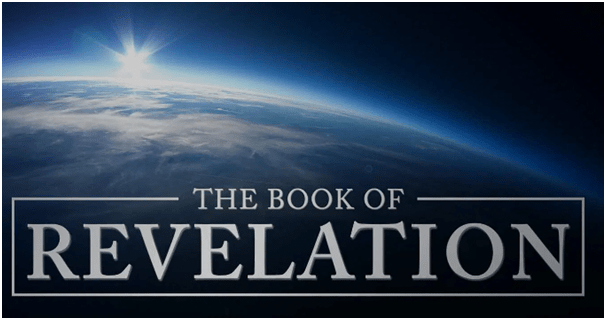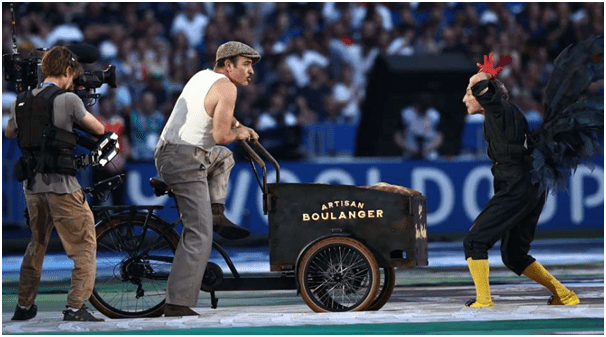par Jean-Marc Bourdin
Ces derniers mois, plusieurs d’entre nous ont cherché à caractériser la théorie mimétique d’un point de vue épistémologique ou herméneutique. Je me contente ici de rappeler trois billets parmi les plus récents
En ce qui me concerne, j’ai récemment suggéré que René Girard procédait par révélations ( https://emissaire.blog/2024/01/02/les-livres-des-revelations/) après avoir tenté d’approcher certains de ses modes de raisonnement https://emissaire.blog/2023/10/31/penser-avec-rene-girard-doubles-sens-diptyques-et-metaphores/ ). Je souhaite compléter ma contribution en adoptant une troisième perspective. Celle-ci nécessitera une longue introduction qui paraîtra peut-être trop éloignée de notre sujet de prédilection. Elle est néanmoins nécessaire pour parvenir à appliquer brièvement cette grille à la pensée de René Girard.
Comment nous représentons-nous les autres et, plus largement, le monde ? En pratique, les quelques prises de position possibles dépendent pour l’essentiel de la distinction entre ce qui provoque chez nous des plaisirs ou des peines, la vie ou la mort, la joie ou la tristesse, l’amour ou la haine, etc.
Une première manière d’aborder ces diptyques est l’opposition du bien et du mal. Nous sommes ici dans le domaine de l’absolu et du tiers exclu. C’est en quelque sorte tout l’un ou tout l’autre. Le manichéisme est au cœur de la plupart des religions et des idéologies, mais se retrouve aussi dans la philosophie platonicienne et sa longue descendance idéaliste. Christianisme, islam, communisme et autres totalitarismes montrent l’importance qu’elle a eu, a et aura dans l’histoire et ce depuis plusieurs millénaires. L’écologisme propose une actualisation de ce qui est bien ou mal à l’ère de “l’anthropocène”.
Cette opposition justifie l’exclusion des “porteurs” ou suppôts du mal afin que le bien triomphe de ses ennemis. Elle fournit son support moral à la désignation de l’ennemi. Au bien et au mal sont aussi associés la certitude d’une vérité unique et le reste qu’elle repousse par voie de conséquence dans le champ de l’erreur.
Les classements qui en résultent dictent les comportements sociaux à adopter ou éviter sous le regard de la communauté : obligations et interdits peuvent être multipliés à l’infini et prennent souvent des formes qui nous semblent étranges [1].
Dans ce mode de réflexion, le changement est possible et le plus souvent souhaitable. Il suppose la révolution, l’apocalypse, l’attente millénariste, l’hérésie, la dissidence ou, sur un mode plus spécifiquement intellectuel, l’utopie et désormais la dystopie. La vérité s’y apparente à une révélation. À chaque fois, il s’agit de faire triompher le bien et/ou la vérité sur le mal et ses obscurités.
Une autre façon de regarder le monde se veut réaliste. Il ne s’agit plus ici de se placer du point de vue du bien et du mal mais d’arbitrer entre des évolutions vers l’amélioré ou vers le détérioré. Les points de vue sont alors multiples. La situation peut être améliorée ou détériorée pour un individu ou une collectivité allant d’un foyer familial jusqu’à un peuple, voire l’humanité dans son entier. Ce qui améliore le sort des uns peut nuire à celui d’autres.
Aristote, Machiavel, Montesquieu ou Tocqueville pensent le plus souvent en réalistes. La plupart des gouvernants décident et mènent des politiques qui se veulent réalistes, qu’ils agissent dans un cadre autoritaire ou libéral. Quels que soient leurs discours et leurs promesses, ils ont désormais conscience de n’agir qu’à la marge et en vue de fins limitées.
L’idée du progrès, en raison même de la progressivité du processus, de même que celle du déclin relèvent du réalisme.
Le rapport à la vérité prend la forme de la science : il s’agit de s’approcher de la réalité sans prétendre l’atteindre complètement. Dans son domaine, le réfutable et le falsifiable de même que le progrès des connaissances ainsi accumulées ont été érigés en dogme.
Contrairement au manichéisme, le mouvement est pour le réaliste un plus ou moins, une tendance plutôt qu’une rupture, un processus continu. Il ne prend pas la forme d’une rupture même s’il partage l’espérance de passer de l’ombre à la lumière, mais pas à pas et non à l’occasion d’une subite conversion ou réception d’une révélation venant d’en haut.
Enfin, dans un certain nombre de situations, il peut sembler que tout se vaut, que je m’interdise d’établir une hiérarchie de préférences, que toutes choses sont égales par ailleurs. L’indifférence prévaut. Cette attitude relève du relativisme. En matière de croyances religieuses, si la foi et l’athéisme sont deux modalités du manichéisme, l’agnostique, empreint d’un doute raisonnable, envisage le monde et l’humanité comme sans différence qu’un (ou plusieurs) dieu(x) existe(nt) ou qu’il(s) n’existe(nt) pas. Plus généralement, il ne peut et ne doit pas exister de vérité unique pour le relativiste. Toutes les vérités sont bonnes à dire… et de même valeur. Il n’y a pas de vérité atteignable sans détour [2], toute opinion ou pensée est à déconstruire. Dans sa version la plus radicale, le relativiste, tel l’âne de Buridan, s’empêche de choisir. La liberté d’indifférence est sa règle. Le relativisme peut aussi conduire au nihilisme : si rien n’a d’importance alors le Rien devient attrayant.
Le relativisme culturel se refuse par exemple à hiérarchiser des croyances qui induisent les sacrifices humains et celles qui ont renoncé à tout sacrifice autre que symbolique. De même, le relativiste ne place pas les sociétés sur une échelle du progrès matériel comme le fait le réaliste. Tout se vaut pour lui.
Une représentation mathématique de notre classification des manières de penser en fonction de ces trois référentiels serait une droite commençant et finissant à l’infini du Mal et du Bien avec en son centre un 0, les demi-droites la constituant étant jalonnées des niveaux possibles de détérioration et d’amélioration.
Prenant parfois la forme pure du manichéisme, du réalisme ou du relativisme, nos croyances, pensées et jugements sont le plus souvent une résultante de deux de ces perspectives, voire des trois. Nous sommes plus syncrétiques que nous ne l’imaginons. Un fondamentalisme religieux ou une idéologie totalitaire doit en passer par des décisions teintées de réalisme pour convertir ou accéder au pouvoir puis maintenir son emprise sur la population de ses adeptes[3]. Un prince machiavélique peut inversement invoquer le bien et le mal pour la conquête et la conservation de son pouvoir. Il peut aussi être soumis à des préoccupations manichéennes par les autorités religieuses comme le suggère la théorie des deux glaives autrefois énoncée par le Pape Gélase [4]. Inévitablement, tout manichéisme et tout réalisme s’accommodent d’une plus ou moins grande part d’indifférence, notamment pour ce sur quoi ils n’entendent pas agir : malgré les tentations totalitaires, il est en effet rare de pouvoir tout englober dans une définition générale de ce qui est bien ou mal et tout réaliste sait qu’il peut agir au plus sur quelques facteurs simultanément, conscient de la vanité des prétentions excessives.
Parmi les sciences humaines, certaines ont plus d’affinités avec tel ou tel point de vue sans qu’il s’agisse ici de les cantonner dans un mode de réflexion exclusif. Les théologiens et les philosophes adoptent souvent un cadre de réflexion manichéen. Les historiens, les démographes, les sociologues et les psychologues se veulent réalistes. Quant au relativisme, il a plutôt la préférence des ethnologues et des anthropologues contemporains qui s’efforcent de s’écarter des préjugés de leurs devanciers.
L’important est d’être en mesure d’identifier dans chaque cas particulier ce qui relève de notre conception du bien et du mal, de notre appréciation de ce qui serait une amélioration ou une détérioration et de ce qui pourrait y conduire, enfin d’évaluer s’il y a ou non à raisonner en l’espèce toutes autres choses égales par ailleurs. Il me semble que cet effort de clarification est de nature à permettre une disputatio plus satisfaisante et de limiter certaines interférences qui pourraient lui nuire. Il faudrait que chaque interlocuteur soit conscient de ce qui relève dans la position qu’il soutient du manichéisme, du réalisme et du relativisme. Une telle lucidité est sans doute difficile à atteindre et plus encore à maintenir durablement.
Le panorama ainsi brossé, qu’en est-il de la pensée de René Girard ?
S’il y a un point sur lequel il ne me semble pas difficile de s’accorder, c’est son refus maintes fois explicité du relativisme. Il existe pour lui une vérité. L’Occident, inventeur du relativisme culturel, n’a pas à nourrir de complexes vis-à-vis du reste du monde. La Bible est le plus puissant des révélateurs que l’humanité ait produit. Il voit dans la perte des différences une menace pour la concorde des collectivités et l’origine des crises. Que la plupart des ethnologues et des anthropologues n’aient pas accueilli un tel pourfendeur du relativisme n’a rien d’étonnant, quand bien même il s’est lui-même voulu anthropologue.
En revanche, il se revendique d’une pensée réaliste. Le titre de son recueil d’essais La voix méconnue du réel le dit de belle manière. Il n’hésite pas à discuter la pertinence de l’impératif poppérien de la réfutabilité de toute théorie qui se veut scientifique. Qu’il ouvre ce débat prouve qu’il se veut et s’estime un scientifique des rapports humains et, par voie de conséquence, se défend lorsqu’il se sent rejeté de ce cénacle. Malgré qu’il en ait et qu’en aient ses contradicteurs, il conserve de sa formation d’archiviste paléographe le souci de la source, de préférence écrite ou archéologique. Il est un historien du temps très long et le père d’une psychologie interdividuelle. En accord avec la modestie des scientifiques, il ne prétend pas être l’auteur des révélations qu’il porte à notre connaissance et a déclaré espérer avoir contribué à une science des rapports humains. Nous pouvons convenir qu’“espérer avoir contribué” est une locution dépourvue d’arrogance et un indice d’une volonté de s’inscrire dans un processus d’accumulation de connaissances. Assez logiquement de ce point de vue réaliste, il maintient ses distances avec les philosophes et même les théologiens : non seulement il a refusé d’être étiqueté de la sorte mais il a rarement manqué une occasion de les critiquer.
Pourtant, s’il se veut non sans quelques arguments solides, réaliste, disons un réaliste hétérodoxe, il n’en est pas moins tout aussi explicitement manichéen. Il y a dès l’origine de son œuvre une invocation de la vérité, une certitude qu’il existe une voie d’accès pour y parvenir. Et pour lui, cette voie d’accès nous a été donnée par la Bible qui nous dévoile Des choses cachées depuis la fondation du monde. Il identifie la violence essentielle au mal absolu. Il s’avoue un apologiste du christianisme, donc d’un manichéisme assumé où Satan qu’il identifie, comme nous le dit Hervé van Baren, au tentateur, à l’adversaire, à l’accusateur, au diviseur et au dissimulateur s’oppose au Dieu trinitaire. Tout ceci pourrait conduire à une sorte de fanatisme. Mais en réaliste conséquent, il confronte immédiatement le mal, non à un bien qui lui serait antagonique, mais à un moindre mal, celui du sacrifice et des institutions qui en découlent. Si l’horizon de la révélation ultime est très tôt présent chez lui, il nous invite à reconnaître qu’une moindre violence peut contenir la violence délétère pour maintenir en vie l’humanité, qu’elle suive pour ce faire des procédures religieuses, politico-judiciaires, voire économiques.
Au terme de cette brève réflexion, il me semble que René Girard est un réaliste manichéen, formule oxymorique seulement en apparence. Si le qualificatif manichéen vous semble péjoratif, nous pourrions parler de la théorie mimétique comme d’un manichéisme réaliste. La cohérence de sa pensée prouve, s’il en était besoin, qu’un équilibre subtil est non seulement possible mais aussi parfois fécond dans la composition de ces deux modes d’appréhension du monde.
[1] Fruit sans doute de corrélations interprétées comme des causalités.
[2] Comme l’a déclaré l’ancienne présidente de l’université d’Harvard devant une commission du Congrès américain interrogée si elle estimait qu’« appeler au génocide des juifs viol[ait] le règlement concernant le harcèlement à Harvard », tout dépend du contexte.
[3] Pensons à la taqiya (dissimulation et tromperie autorisée par la doctrine) que pratiquent les islamistes dans l’intérêt de l’islam.
[4] Extrait de Wikipedia : “ selon cette théorie, le pouvoir spirituel possède un ascendant moral et politique sur le pouvoir temporel exercé par le prince en vertu duquel celui-ci préside aux destinées des hommes dans le respect strict des préceptes religieux.”