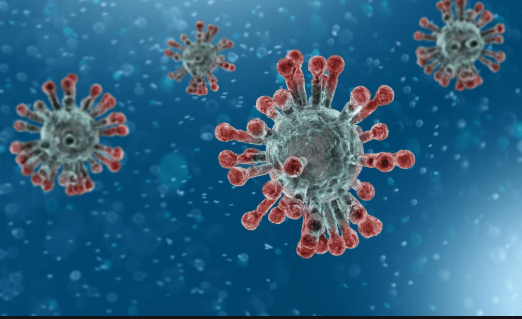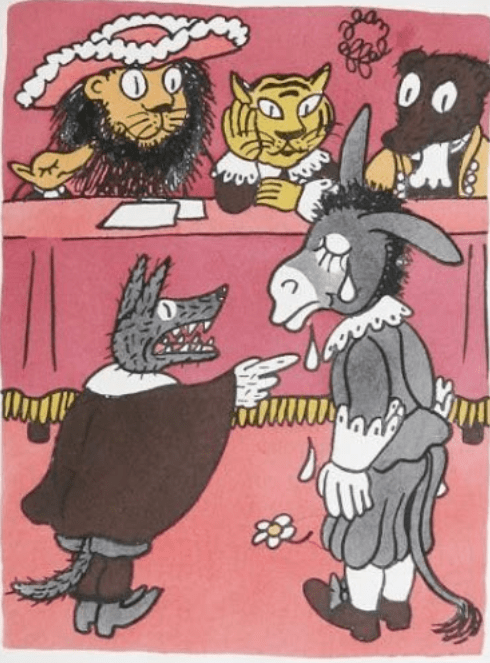par Hervé van Baren
S’il est une destinée humaine qui mène à la plénitude lors d’une crise radicale, c’est celle d’Etty Hillesum. Jeune Juive hollandaise sous l’occupation nazie, Etty rédige ses carnets intimes (1) entre 1941 et sa mort à Auschwitz en 1943.
La démarche d’Etty n’est pas historique. Dans ses écrits, la focale de son objectif est réglée sur sa vie intérieure ; la guerre et la situation des Juifs d’Europe forment un fond distant et flou.
Cela recommence : arrestations, terreur, camps de concentration, des pères, des sœurs, des frères arrachés arbitrairement à leurs proches. On cherche le sens de cette vie, on se demande si elle en a encore un. (p. 37)
Etty nous montre la voie à suivre lorsque nous sommes emportés par une crise. Celle qui ravage son monde est extrême à tout point de vue. Son histoire montre bien à quel point il est des circonstances qui nous enlèvent tout pouvoir de changer quoi que ce soit à notre destin. La crise est ce lieu qui nous invite à remplacer le faire et l’avoir par l’être. La singularité ne lui concède qu’une seule liberté : devenir pleinement elle-même.
L’homme forge son destin de l’intérieur, voilà une affirmation bien téméraire. En revanche, l’homme est libre de choisir l’accueil qu’il fera en lui-même à ce destin. (p. 105)
Cette liberté ne peut être acquise que par l’accès à la pleine conscience. Pour pouvoir choisir entre le salut et la perdition, il faut arracher les voiles mythologiques qui nous cachent le réel, s’élever au-dessus de la confusion entre bien et mal qui caractérise la régularité. Dans sa quête existentielle, Etty dénonce un à un tous les mensonges romantiques, renonce à tous les désirs. Elle acquiert au fil des jours une conscience exceptionnelle, qui lui permet de se confronter à tous les aspects du réel, y compris les plus insoutenables, sans basculer dans le désespoir ou dans la haine :
Je connais l’air traqué des gens, l’accumulation de la souffrance humaine, je connais les persécutions, l’oppression, l’arbitraire, la haine impuissante et tout ce sadisme. Je connais tout cela et je continue à regarder au fond des yeux le moindre fragment de réalité qui s’impose à moi. (p. 119)
Etty voit dans cette évolution de son être quelque chose de profondément intime, et même si elle ne reconnaît pas le rôle du médiateur dans le désir, elle en décrit remarquablement les conséquences :
J’avais une nature trop sensuelle, trop « possessive », dirais-je. Ce que je trouvais beau, je le désirais de façon beaucoup trop physique, je voulais l’avoir. Aussi j’avais toujours cette sensation pénible de désir inextinguible […] (p. 21)
Parfois apparaît l’intuition de la nature mimétique du rapport à l’Autre :
L’essentiel est […] d’être à l’écoute de ce qui monte de soi. Nos actes ne sont souvent qu’imitation, devoir supposé ou représentation erronée de ce que doit être un être humain. Or la seule vraie certitude touchant nos vies et nos actes ne peut venir que des sources qui jaillissent au fond de nous-mêmes. (p. 91)
Elle perce le mur qui nous cache la réalité du désir métaphysique, du paradoxe attraction-répulsion du scandale :
Ne pas vouloir s’approprier l’autre, ce qui ne revient d’ailleurs pas à renoncer à lui. Lui laisser une liberté totale, ce qui n’implique nulle résignation. Je commence à discerner maintenant la nature de ma passion dans mes relations avec Max. C’était le désespoir de sentir l’autre finalement inaccessible qui me portait au comble de l’excitation. (p. 72) :
Au fur et à mesure qu’elle se libère des passions tristes du mimétisme envieux, elle gagne en empathie et en capacité d’aimer.
Depuis hier soir, j’ai ressenti dans ma chair, une fois de plus, ce que doit être en ce moment la souffrance des gens […] (p. 228)
Sa connaissance d’elle-même progresse en parallèle avec sa connaissance des autres :
Tous les mots, toutes les phrases jamais utilisées par moi dans le passé me semblent en ce moment grisâtres, pâlis et ternes au prix de cette immense joie de vivre, de cet amour et de cette force qui jaillissent en moi comme des flammes. (p. 224)
Comment faire pour que d’autres lisent avec moi à livre ouvert dans tous ces gens qu’il faut déchiffrer comme des hiéroglyphes, trait par trait, jusqu’à ce qu’ils composent un tout lisible et intelligible, un monde pris entre ciel et lande ? (p. 215)
Le parcours est chaotique, les états d’exaltation alternent avec les états dépressifs.
Je suis une femme heureuse et je chante les louanges de cette vie, oui vous avez bien lu, en l’an de grâce 1942 […] (p. 133)
Angoisse devant la vie à tout point de vue. Dépression totale. Manque de confiance en moi. Dégoût. Angoisse. (p. 71)
A priori, il est facile de diagnostiquer un trouble bipolaire, mais encore une fois, la vision de la singularité depuis l’extérieur est biaisée, elle ne peut rendre compte de la réalité. La psychologie n’a jamais su différencier les états psychiatriques pathologiques des comportements transitoires observés chez une personne affectée par une crise violente. De manière plus générale, l’adoption de la méthode scientifique pour tenter de comprendre l’humain se heurtera toujours à la frontière entre régularité et singularité anthropologique. L’approche purement scientifique de l’humain est condamnée à l’échec par un paradoxe. La science, par définition, s’interdit le point de vue de la singularité, qui en sape les fondements ; la raison, la logique, l’objectivité y sont profondément altérées. Témoigner de l’expérience intime de la crise est réservé aux poètes et aux prophètes.
L’épreuve, en décantant l’accessoire, laisse apparaître l’essentiel :
Tant de beauté et tant d’épreuves. Et toujours, dès que je me sentais prête à les affronter, les épreuves se sont changées en beauté. […] Qu’un simple cœur humain puisse supporter tant de choses, mon Dieu, tant souffrir et tant aimer ! (p. 199)
Rien ne permet d’affirmer que le parcours spirituel d’Etty est conditionné à une crise. Cependant, ce n’est pas tant ce parcours en lui-même qui nous étonne et nous touche. C’est qu’il ait lieu dans les circonstances que nous connaissons. Etty progresse vers l’amour, la conscience et la liberté là où la grande majorité de ses contemporains se laissent emporter par le désespoir, la haine et la peur. Elle remonte à contre-courant toutes les malédictions, elle dément tous les fatalismes. Etty va chercher la vie là où nous ne voyons que la mort.
Je suis dans des dispositions singulières. Est-ce bien moi qui écris ici avec autant de paix et de maturité ? Et saura-t-on me comprendre si je dis que je me sens étonnamment heureuse, non pas d’un bonheur exalté et forcé, mais tout simplement heureuse, parce que je sens douceur et confiance croître en moi de jour en jour ? Parce que les faits troublants, menaçants, accablants qui m’assaillent ne produisent chez moi aucun effet de stupeur ? Parce que je persiste à envisager et à vivre ma vie dans toute la clarté et la netteté de ses contours. Parce que rien ne vient troubler ma façon de penser et de sentir. (p. 159)
Au lecteur donc de décider si ce témoignage confirme ou pas notre intuition de départ. La singularité anthropologique est-elle la condition pour pouvoir nous extraire du mimétisme d’appropriation, pour échapper au mécanisme victimaire, pour vaincre notre violence ? S’il en est ainsi, alors il nous faut d’urgence apprendre, non seulement à accepter les crises qui nous ravagent, mais à les accueillir avec reconnaissance. Alors la très choquante phrase de Jésus prend tout son sens :
« C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Luc 12, 49)
Les événements récents et d’autres à venir nous précipiteront tous et toutes, selon toute vraisemblance, dans une crise inédite par son ampleur et son étendue. Cette affirmation se heurtera certainement à bien des rejets ; c’est que, dans le deuil que nous devons faire du monde tel que nous le connaissons, nous en sommes encore au stade de la sidération et du déni. La crise sera pour nous tous, individuellement et collectivement, le test de notre capacité à échapper au sort habituel des humains dans de pareilles circonstances. Serons-nous capables de résister à la voix de la foule, qui nous dit de trouver un coupable à nos malheurs ? Pourrons-nous, comme le roi Ezéchias, parcourir une à une les étapes du deuil, choc et déni, culpabilité, colère, négociation, dépression, pour reconstruire notre monde et gagner au passage – c’est en option – la paix et la liberté ? La crise ouvre sur tous les possibles, mais surtout, en nous dépouillant à notre corps défendant des artifices et des mensonges qui soutiennent nos vies et nos communautés, elle nous fait l’inestimable cadeau de nous laisser libres de choisir.
(1) Toutes les citations sont extraites de « Une vie bouleversée », Editions du seuil / Points, 2007. Les extraits bibliques viennent de la TOB.