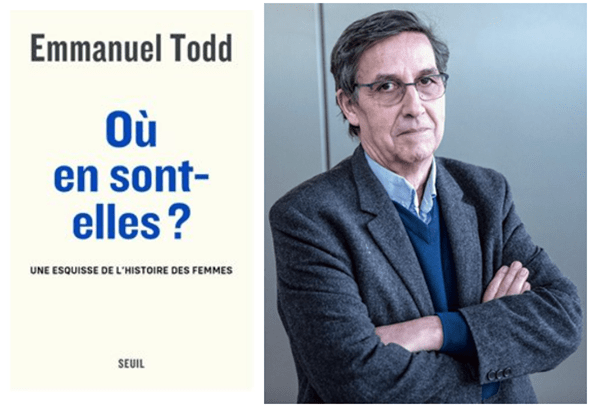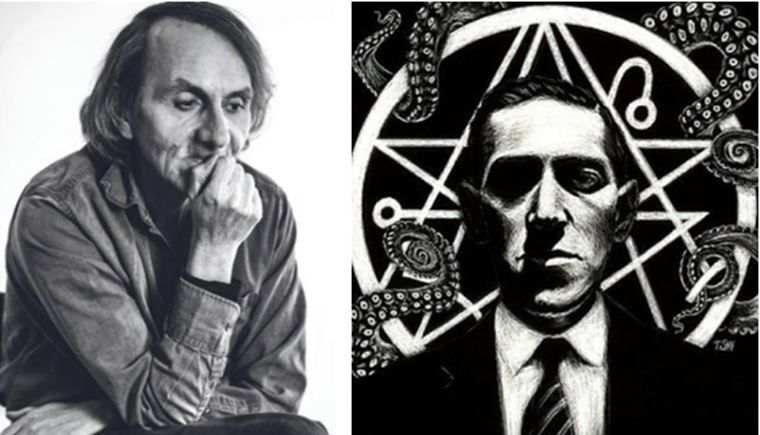A l’issue de la dernière assemblée générale de l’Association Recherches mimétiques, Paul Dumouchel, philosophe majeur de la théorie mimétique, qu’il a largement contribué à étendre dans les champs de l’économie (notamment avec son essai intitulé L’ambivalence de la rareté, publié dès 1979 dans L’enfer des choses aux éditions du Seuil, écrit avec Jean-Pierre Dupuy) et du politique (voir Le sacrifice inutile paru en 2011 aux éditions Flammarion) nous a offert une conférence dont la captation est disponible sur le site de l’ARM : https://www.youtube.com/watch?v=Fd3v4k3iFfU
Pour ceux d’entre nous qui aiment lire les textes pour mieux en approfondir le contenu, Paul Dumouchel nous a autorisés à le publier dans notre blogue. Nous avons fait le choix de le publier in extenso d’une seule traite. Bonne lecture et bonne(s) réflexion(s).
Résumé
Il y a peu, dans la dernière décennie du siècle dernier, avec la chute de l’URSS, la libéralisation économique de la Chine, le virage démocratique de plusieurs pays africains, nous avons assisté au triomphe de la démocratie qui semblait devoir bientôt s’installer durablement sur l’ensemble de la planète. Les quelques monarchies arriérées et les régimes dictatoriaux restants étant appelés à disparaître à plus ou moins brève échéance. Aujourd’hui la démocratie semble en crise presque partout et cette crise est de plus inséparable de plusieurs autres : crise du climat, crise économique, crise des migrants, pandémie, crise de l’ordre international, pour n’en nommer que quelques unes. Quel éclairage peut donner la théorie mimétique sur ces crises en série et sur l’évolution qui, en l’espace de trente années, a conduit du triomphe au désenchantement de la démocratie et à la montée de l’autoritarisme politique ?
*****
La Charte de Paris
En novembre 1990, plus ou moins un an jour pour jour après la chute du mur de Berlin, fut signé la Charte de Paris pour un nouvelle Europe. Sa première section s’intitule « Une nouvelle ère de démocratie, de paix et d’unité ». Elle déclare que l’Europe se libère des legs du passé et que s’ouvre une nouvelle période où s’affirmeront les droits de l’homme, la démocratie et les règles du droit. Les signataires [1] s’engageaient à consolider et à renforcer la démocratie comme le seul système de gouvernement de leurs pays. Dans les mois et les deux années qui suivront, on assistera à un développement d’aventures démocratiques un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Transitions démocratiques encouragées et appuyées par les pays riches et puissants signataires de la charte.
Il est vrai qu’au même moment ou presque, en juin 1989, avait lieu le massacre de Tian’anmen, mais la Chine, c’était très loin et cette répression anti-démocratique a plutôt été vue à l’époque comme un accident de parcours dans le processus de libéralisation de la Chine. Il est vrai aussi que huit mois après la signature de la charte commençait en Yougoslavie (un des pays signataires) une guerre civile entre différents ennemis « nationaux » : Croates, Serbes, Slovaques, Bosniaques, Kosovars et Macédoniens. Une guerre qui allait durer dix ans. Mais cela fut compris sur le moment comme un legs du passé plutôt que comme un avertissement pour l’avenir. Les pays des Balkans, disait-on, étouffés sous la chape de plomb du communisme, reprenaient cinquante ans plus tard un conflit là où ils l’avaient laissé. Bref, cette guerre renvoyait à une histoire ancienne. La victoire universelle de la démocratie n’était pas remise en cause par elle et nous étions au début d’un avenir de paix et d’unité.
Aussi, deux après la signature de la Charte de Paris, Francis Fukuyama écrivait dans La fin de l’histoire et le dernier homme (1992) que la victoire idéologique du capitalisme et de la démocratie libérale, de même que l’échec politique et économique du communisme marquaient la fin de l’histoire. Il n’y aurait plus de guerres et les êtres humains allaient dorénavant se satisfaire d’une vie de paisibles consommateurs n’ayant plus d’idéaux politiques à défendre.
Aujourd’hui, trente ans plus tard, la démocratie, partout, est en recul et menacée. D’une part, des pays comme la Russie, la Turquie, la Hongrie ou la Pologne, alors considérés comme pays phare de la nouvelle période de la démocratie, semblent y renoncer et rejeter les idéaux libéraux. Leurs gouvernements briment la liberté de presse et d’expression et tentent de limiter l’indépendance du judiciaire. D’autre part, dans les pays de longue tradition démocratique, comme la France, les États-Unis, les Pays Bas ou le Royaume Uni, mais aussi en Allemagne et en Italie s’installe un désenchantement à l’égard de la démocratie. Les alternatives populistes et autoritaires gagnent en force et crédibilité, tandis que les partis traditionnels, les garants et les gardiens de la démocratie, sont en perte de vitesse et de légitimité. De plus, souvent ces partis, pour ainsi dire, passent de l’autre côté, adoptent les politiques de leurs adversaires populistes par peur d’un échec électoral. En Europe et aux États-Unis règne la peur de l’autre et de l’étranger. La méfiance à l’égard des immigrants et des réfugiés caractérise nos politiques officielles. Et se multiplient les appels à la pureté ethnique, aux valeurs traditionnelles, à la nation ou à la supériorité culturelle et raciale des occidentaux. Enfin une guerre tiède, ni froide ni tout à fait chaude continue depuis plus de sept ans à la frontière de la Russie et de l’Ukraine (NdE : ce texte date de décembre 2021). Bref, en une génération, la victoire qu’on disait historique, finale et définitive de la démocratie libérale, victoire des idéaux de liberté individuelle, de tolérance et d’égalité qui allait conduire à la paix universelle s’est transformée en une avalanche de guerres et de crises politiques dont nul ne voit la fin.
Malgré cela, il ne faut pas trop se moquer de Francis Fukuyama, même si les événements eurent tôt fait de le démentir. Si pas plus que l’histoire, la guerre ne s’est arrêtée, les différents conflits militaires qui ont marqué et qui marquent encore la scène internationale pour la plupart, ne sont pas proprement des guerres. Ce ne sont pas des guerres au sens où on l’entendait jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ni même au sujet des guerres coloniales et de libérations nationales qui lui firent suite. Toutes nos interventions, soit au nom des droits de l’homme, soit pour « punir » un belligérant d’avoir utilisé des armes chimiques ou bombardé des hôpitaux, bref d’avoir transgressé les lois de la guerre, s’apparentent plus à des opérations policières – parfois monstrueusement meurtrières – qu’à des guerres proprement dites. Car il ne s’agit pas de gagner, ni d’imposer notre volonté à l’adversaire[2] mais de rétablir un ordre malmené ou de punir ceux qui l’ont transgressé. En ce sens, Fukuyama n’avait pas tort; il n’y a plus de guerre à proprement parler, mais seulement ce qu’on a nommé des « états de violence ».[3] Et conformément à ce qu’il avait prédit, à l’interne nos différends politiques ne reposent plus sur une opposition idéologique, par exemple entre la gauche et la droite, ou entre les libéraux et les conservateurs, ni ne renvoient à des projets de sociétés différents. Ils opposent différentes façons de gérer les multiples crises auxquelles nous avons à faire face : crise migratoire, crise climatique, écologique, économique ou culturelle. Plutôt que des conflits idéologiques, ce qui nous divise ce sont des débats de gestionnaires.[4]
Les nombreuses interventions internationales qui ont pour but de punir les « méchants » ou de protéger des populations menacées, tendent en fait à détruire l’ordre qu’elles visent à défendre. L’ordre international dont nous avons hérité à la fin de la Seconde Guerre repose sur des frontières reconnues entre les états et sur le droit. La guerre contre le terrorisme et les interventions, humanitaire ou autres, ne respectent ni les frontières ni la souveraineté des états, pas plus que ne le font les assassinats politiques ou les bombardements punitifs qui sont devenus la monnaie courante des différends internationaux. Quant au droit international comme moyen de résoudre les conflits, de plus en plus les négociations ou le chantage le remplacent. Ainsi, lorsque en raison d’un mandat d’arrêt international lancé contre elle par les États-Unis, les autorités canadiennes ont arrêté Meng Whanzou, directrice financière de Huawei, la Chine a aussitôt emprisonné deux ressortissants canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, qui, comme par hasard, ont été relâchés deux ans plus tard,[5] très exactement le lendemain du jour où les États-Unis ont abandonné les poursuites contre Meng Whanzou. La Chine indiquait clairement par là qu’il n’était pas question de régler ce genre d’affaires en faisant appel au droit international, mais en négociant quelle que soit la monnaie d’échange.
La fin de la longue guerre
Philip Bobbitt (2002)[6] considère que la Charte de Paris marque la fin de ce qu’il nomme la longue guerre, laquelle débuta en 1914. Cette guerre d’époque, au sens où elle structura tout un siècle, comprends en plus de la Première Guerre, la révolution et la guerre civile Russe, la guerre civile d’Espagne, la Seconde guerre mondiale, les guerres de Corée et du Vietnam, ainsi que la guerre froide. Tous ces conflits, toutes ces guerres ensemble constituent selon lui, une même longue guerre dont l’enjeu était de déterminer la forme constitutionnelle de l’état-nation. Un état qui, plutôt que de s’identifier au prince ou au conquérant, s’identifie à la nation et tire sa légitimité de l’accord populaire. Il y avait trois candidats en liste : le fascisme, le communisme et la démocratie libérale, qui se sont affrontés durant tout le court vingtième siècle. Le conflit ne s’est terminé qu’en 1990 avec la victoire complète et finale de l’un des trois partis. Mais cette victoire a laissé la démocratie libérale sans adversaire.
La thèse fondamentale de Bobbitt est que la forme constitutionnelle de l’état moderne, en particulier la question de sa légitimité, est inséparable des transformations de la stratégie militaire et inversement que les stratégies militaires accessibles à un état, dépendent de sa forme constitutionnelle. Or, comme l’état moderne est le détenteur du monopole de la violence légitime, cette thèse selon moi est tout à fait girardienne puisqu’elle dit simplement que les mécanismes internes et externes de la gestion de la violence sont étroitement liés. Certes, beaucoup d’autres facteurs entrent en jeu dans l’évolution de la forme constitutionnelle et de la stratégie militaire que leur rapport réciproque entretient, par exemple le développement des armements, mais il importe de ne pas considérer ces deux réalités comme indépendantes l’une de l’autre.
On peut illustrer cette dépendance réciproque à l’aide d’un exemple historique connu. Avec la Révolution, la légitimité de l’état français se fonde sur le fait qu’il est l’expression de la nation entière. Dès lors, les levées en masses deviennent possibles et tous les citoyens peuvent être appelés à participer à l’effort de guerre. La nouvelle forme de légitimité de l’état change la stratégie militaire et c’est cette transformation guerrière qui permit à la république française de survivre et rendit possible les victoires napoléoniennes. De telles levées populaires étaient impossibles dans un état comme la Prusse ou l’Autriche, dont la légitimité était dynastique. Elles étaient impossibles car elles remettaient en cause le principe de leur légitimité. Ce qui arriva par la suite. En réponse à ces transformations stratégiques, les monarchies au cours du dix-neuvième siècle vont abandonner la pure légitimité dynastique. Elles vont se faire constitutionnelles et nationales. Cette interdépendance entre stratégie et forme constitutionnelle de l’état n’est pas un lien causal, mais un rapport d’influence réciproque. Les transformations d’un pôle exigent des transformations de l’autre, et vice versa, mais ils ne les déterminent pas strictement. Dès lors, cette interdépendance donne naissance à des formes et à des arrangements particuliers sous l’influence d’événements contingents, par exemple le rôle de Napoléon ou de Bismarck dans l’histoire des développements stratégiques et de l’état nation.
La fin de la longue guerre va elle aussi conduire à une transformation de l’état, en partie liée aux innovations stratégiques qui ont rendu possible la victoire des démocraties libérales, en particulier l’arme nucléaire. Lorsque les États-Unis l’ont utilisée pour les deux premières fois dans la guerre du Pacifique, ils ont traité les bombes atomiques comme si elles étaient tout simplement de plus grosses bombes, dont l’incroyable force de frappe était capable de contraindre l’ennemi japonais à se rendre. Cependant, une fois que l’adversaire a lui aussi des armes nucléaires, leur valeur stratégique change, il ne s’agit plus simplement d’une bombe plus puissante, mais d’une arme qui n’est utile et ne protège qu’aussi longtemps qu’on ne l’utilise pas. D’une part, les armes nucléaires donnent un avantage absolu à ceux qui en ont par rapport à ceux qui n’en possèdent pas. D’autre part, elles limitent, sinon interdisent les conflits directs entre ceux qui les possèdent. Du moins, lorsque les adversaires sont tous deux des états territoriaux. Par contre, si l’ennemi est anonyme et sans domicile fixe, comme un groupe terroriste, ces armes perdent pour les états territoriaux, tant leur avantage stratégique que leur valeur dissuasive.
Si comme je l’ai proposé dans Le Sacrifice inutile la légitimité de l’état moderne détenteur du monopole de la violence légitime peut être comprise comme une variation sur le mécanisme victimaire, où tous reconnaissent comme leur, c’est-à-dire comme bonne, la violence de l’état, cette violence doit essentiellement s’exercer contre des victimes acceptables. Elle doit viser des cibles extérieures à la communauté ou des criminels, ceux qui sont déjà déchus à ses yeux. C’est ce que faisait fort bien l’état nation. Il tournait sa violence contres des étrangers, que l’extériorité au territoire national rendait sacrifiables. L’état avait pour but de protéger ses citoyens contre les ennemis extérieurs et de leur garantir une vie bonne. L’extériorité des cibles de la violence de l’état est indispensable à la légitimité de l’état nation, à sa capacité de maintenir l’ordre et la paix. Car le monopole de la violence légitime est d’abord le monopole moral de l’état de seul pouvoir dire[7] la différence entre la bonne et la mauvaise violence.
Cependant, tout état qui n’est pas le seul à détenir l’arme nucléaire offre par définition sa propre population en otage à son adversaire nucléaire. Car c’est l’unique garantie que chacun puisse donner qu’il ne fera pas le premier usage de sa puissance dévastatrice. En conséquence, le pouvoir nucléaire ne tourne pas vers l’extérieur la violence de l’état. Il achète la puissance de l’état au prix d’offrir sa propre population comme victimes potentielles. Pour le dire autrement, l’état nucléaire ne peut protéger sa population qu’en étant prêt à la sacrifier. L’innovation stratégique qui a permis la victoire des démocraties libérales sape la base sur laquelle repose la légitimité de l’état nation. Elle rend impossible que les membres de l’état reconnaissent sa violence comme leur, impossible qu’ils acceptent d’emblée comme bonne la violence de l’état qui les offre comme victimes potentielles. Ce manque de légitimité, que la violence de l’état ne soit plus d’office acceptée comme bonne, non pas par des adversaires, mais par tout un chacun des citoyens, c’est-à-dire par ceux qui sont ses membres ordinaires plutôt que des ennemis, n’est pas qu’une simple possibilité théorique. C’est un événement bien réel dont la réaction de la jeunesse américaine contre la guerre du Vietnam constitue un exemple paradigmatique.
L’état marché
Dès lors que l’état ne peut plus compter sur l’accord spontané de ses citoyens pour soutenir sa propre violence, il est amené à trouver d’autres façons de la légitimer. Premièrement, il va éloigner les citoyens d’un exercice dont ils s’éloignent eux-mêmes. En termes clairs, les armées nationales de conscrits sont remplacées par des armées de métier et par des compagnies privées de sécurité, des mercenaires, qui jouent un rôle de plus en plus important dans les conflits internationaux.[8] Et les citoyens s’opposent d’autant moins à l’usage de la force militaire de l’état que celle-ci les concerne moins, qu’ils ne sont pas directement mis à contribution. Deuxièmement, les gouvernements démocratiques vont présenter leur violence comme ayant des objectifs qui sont bons en eux-mêmes : la protection de populations menacées, la défense de pays agressés, la punition de ceux qui transgressent le droit international. Les raisons du recours à la violence doivent être telles que l’état est susceptible d’obtenir sinon l’accord de la majorité, du moins son acceptation passive, son indifférence. Significativement, ce qui a disparu de cette liste de justifications de l’usage de la force militaire, c’est l’intérêt national. Il n’y a plus de justification de la violence que tous peuvent reconnaître, et de plus en plus d’individus doutent des raisons invoquées par l’état.
En réponse à cette perte de légitimité, les options stratégiques de l’état changent elles aussi. Les armées se font plus petites. Plutôt qu’à des forces massives, on fait appel à des frappes aériennes et/ou à des petites unités de forces spéciales extrêmement bien équipées et entraînées. Celles-ci n’ont pas pour but de rester longtemps à l’étranger ou d’occuper le territoire ennemi, ni même tant de détruire l’adversaire que de le forcer à abandonner certaines tactiques ou à rejoindre la table de négociation. Les états investissent massivement dans le développement d’armes plus sophistiquées et de robots, d’armes létales autonomes, qui exigent moins de combattants et libèrent l’usage de la force militaire de sa dépendance à l’égard du soutien populaire. On compense le moindre nombre de soldats par des armes intelligentes, plus puissantes et destructives. Ainsi le recours massif aux drones par l’administration Obama avait pour but de maintenir la pression sur les Talibans ou sur Isis (NDE : Daech) tout en réduisant le contingent. Or si ces armes, par leur puissance destructive supérieure, peuvent assurer de façon ponctuelle et répétée la victoire sur le terrain, elles ne peuvent occuper un pays. Comme le montrent les expériences américaines et internationales en Irak et en Afghanistan, il n’est plus possible d’occuper le territoire ennemi ni même à proprement parler de le conquérir, car les hostilités ne prennent jamais fin. Dans ces conditions, le but des opérations militaires est alors de forcer l’adversaire à accepter un certain comportement en lui faisant payer cher tout écart ou tentative d’en changer.
Parce que la légitimité de la violence qu’exerce l’état ne va plus de soi, il la voit exposée à la censure de nombreux citoyens qui la critiquent pour de nombreuses raisons, qui vont de l’intérêt individuel à divers idéaux. Cette perte d’autorité morale fait qu’il devient incapable de donner une définition unique et partagée de la vie bonne. Aussi la conception dominante de la démocratie libérale est-elle devenue celle d’une société où coexistent de nombreuses conceptions différentes de la vie bonne. Or une telle façon de comprendre la démocratie entraîne nécessairement une transformation du rôle de l’état. Son rôle n’est plus d’assurer une vie bonne à l’ensemble de ses membres, mais de procurer des services dont chacun fera l’usage qui lui convient. Plutôt que de proposer un idéal de vie commun, son objectif devient celui de maximiser les possibilités d’action de chacun. C’est ce que Bobbitt (2002) nomme l’état marché par opposition à l’état nation.
Le fond du problème, que Bobbitt ne semble pas voir, est que l’état marché est incapable de remplir ce rôle, car il ne s’agit pas tant de maximiser les possibilités d’actions de chacun que de concilier les différentes aspirations et les désirs des individus. Ce que le marché, lui, ne peut faire que grâce à la protection de l’état justement. Lequel limite l’expression des intérêts individuels et force les individus à accepter comme juste les résultats de l’échange marchand. Or si la « monnaie électorale » permet l’expression des intérêts opposés, elle est incapable de les concilier. La victoire de la majorité n’est possible que soit par la force, soit parce que la minorité l’accepte. Ce qui exige que la minorité politique ne corresponde ni à une minorité sociale, ni à une minorité ethnique. Au sein de l’état nation, ce fut toujours la règle que tous se reconnaissaient identiquement dans la nation, dont le fondement était la capacité de l’état de détourner vers l’extérieur la violence de chacun.
Lorsque l’état est lui-même conçu comme marché, comme un moyen de distribuer des biens et des services, et que les personnes ne reconnaissent plus sa violence comme leur, il n’y a plus ni majorité, ni minorité, parce qu’il n’y a plus d’identité commune. Ce déficit d’identité partagée se manifeste de deux façons différentes et à première vue radicalement opposées. D’une part, par le désir nostalgique d’un retour à une identité nationale idéalisée. D’autre part, par la multiplication des revendications identitaires des divers groupes et individus, revendications qui sont toutes par définition minoritaires. Aussi différentes que soient ces deux formes de revendication politique, toutes deux sont des expressions d’une même angoisse identitaire, du même échec du transfert de la violence de chacun à la violence de l’état. Car toute revendication d’identité est une forme d’opposition à l’autre, une façon de marquer sa différence propre, de se distinguer et de se séparer des autres.
Il est intéressant à cet égard que plusieurs des différentes identités dont on réclame l’égale reconnaissance correspondent à des différences invisibles. Être gay, trans ou bisexuel, par exemple, contrairement à être d’une autre origine ethnique ou parler une langue différente, n’est pas de soi-même une différence socialement évidente. La revendiquer exige d’afficher, de rendre publique une caractéristique qui n’est pas par elle-même immédiatement apparente aux yeux de tous. De plus, la demande pour qu’elle soit reconnue, consiste souvent à arguer que cette différence, si importante pour ceux qui la revendiquent, ne devrait pas faire de différence aux yeux des autres, qu’elle ne justifie pas que ceux qu’elle caractérise soient traités différemment de tous. En ce sens ces différences invisibles s’inscrivent au sein d’une identité commune recherchée.
À l’opposé, sont rejetées et refusées au nom d’une identité unique partagée, des différences socialement évidentes. Être musulman, réfugié, migrant, être autre d’une altérité manifeste, qui est visible et reconnaissable sans avoir à être reconnue, c’est ne pas pouvoir la faire reconnaître. C’est se voir interdire de réclamer sa différence. C’est être contraint de la cacher ou (si cela est possible) d’y renoncer. Cette distinction entre les différences visibles et celles qui sont occultes, permet qu’on puisse, sans y voir de contradiction, à la fois refuser l’autre et accepter toutes les altérités spécifiques qui promettent de s’effacer dans une identité commune et partagée. D’où le fait que nos sociétés peuvent être tout à la fois libérales, progressistes et tolérantes à l’interne tout en étant profondément xénophobes.
Lorsqu’a commencé la crise des migrants en 2014 et 2015, au moment où le plus grand nombre d’immigrants et de réfugiés se sont présentés aux portes de l’Europe, on estime qu’ils totalisaient environ un million et demi de personnes en deux ans. Cela fait un très grand nombre, cependant si on se souvient que la population totale de l’Europe est d’un peu plus de 500 millions, cette « invasion » représente environ 0,3% de la population de l’Europe. Ce qui peut difficilement être compris comme un grand remplacement. À l’époque déjà les statistiques de Frontex, l’agence de protection des frontières européennes, indiquaient qu’entre 80 et 90% des migrants provenait de la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan et la Bosnie, quatre pays qui ont été la cible d’opérations militaires de la part des pays européens et occidentaux. Aujourd’hui, ceux qui gèlent et meurent à la frontière de la Pologne viennent en majorité, semble-t-il, de l’Afghanistan. Le plus récent échec de nos aventures militaires.
Le fait est que cette « crise » dure depuis bientôt sept ans. Pendant ces années, les pays occidentaux n’ont à aucun moment reconnu leur responsabilité dans le phénomène migratoire ou tenté de résoudre le problème autrement qu’en renforçant les protections frontalières. Or une crise qui dure sept ans n’est plus une crise, c’est un état de fait accepté. Que d’autres, déplacés en partie par nos aventures militaires, viennent mourir aux portes de nos pays, n’est ni un accident, ni un événement extraordinaire, mais un phénomène normal qui fait maintenant partie de l’ordre établi. Le bien fondé de cette politique qui ne consiste à ne rien faire et à criminaliser l’aide à ces personnes en détresse est reconnu par tous nos gouvernements et soutenu par une grande majorité de la population. Bref, ces migrants et réfugiés sont des victimes sacrifiables. Extérieurs à la communauté, ils constituent des cibles acceptables de notre violence, des victimes de rechange dont le sacrifice inutile échoue à ramener la paix parmi nous.
N’étant plus l’expression de la volonté commune, ayant perdu son monopole moral de la force légitime, l’état n’est plus qu’un acteur social parmi d’autres, dont les décisions sont évaluées en fonction des avantages et des désavantages qu’elles procurent aux différents groupes et individus. Comme ces décisions se manifestent sous la forme de règles universelles que chacun juge selon son propre point de vue, il est inévitable qu’elles conviennent mieux à certains qu’à d’autres. L’état apparaît alors nécessairement comme ayant un intérêt particulier ou comme étant à la solde de certains. Il s’ensuit une perte de confiance en ces décisions dont témoignent et la prolifération des théories de la conspiration et les réactions violentes aux mesures de santé en raison de la pandémie.
Contrairement à ce que prêchent les théories du contrat social, ce n’est pas la raison qui a rendu possible la naissance de l’état moderne, c’est au contraire le monopole de la violence légitime qui a rendu possible la raison. C’est-à-dire une rationalité commune conduisant à des conclusions partagées plutôt qu’une raison individuelle conçue comme mécanisme qui vise à maximiser la probabilité qu’un agent atteigne ses objectifs. L’irrationalité manifeste des différentes formes d’opposition, par exemple aux migrants ou aux mesures sanitaires, irrationalité qui n’empêche en rien leur succès, indique la perte du monopole moral de la violence légitime par l’état et la disparition d’une communauté politique, une communauté capable d’agir ensemble et de reconnaître un danger commun et partagé.
Depuis les années 2000s et le début de la « guerre contre le terrorisme », la sécurité est devenue un thème central du débat politique. En particulier est devenu central le lien entre sécurité et liberté. L’une et l’autre étant représentées comme un système de vases communicants : plus de sécurité exige moins de liberté et vice versa plus de liberté implique moins de sécurité. Ici encore la question de la légitimité de l’état est fondamentale, car on conçoit sa mission comme étant de protéger ses citoyens contre la violence qu’ils exercent les uns contre les autres et contre celle qui vient de l’extérieur. Or le succès des démocraties libérales qui mit fin à la grande guerre conduisit au démantèlement de l’ordre territorial. C’est-à-dire, d’un ordre mondial où le rapport entre l’intérieur et l’extérieur est évident et où, comme j’ai tenté de le montrer ailleurs,[9] idéalement la distance physique correspond à l’éloignement culturel et moral. Plus on est loin dans l’espace physique, par exemple, des réfugiés venus d’Afrique ou du Moyen-Orient, et plus on est éloigné dans l’espace culturel et moral, immédiatement perçus comme porteurs de valeurs non-occidentales, et considérés comme des violeurs, des voleurs et des assassins.
Du démantèlement de l’ordre territorial témoignent la thématique et la rhétorique de la globalisation.[10] Contrairement à la nation, le monde globalisé est sans extérieur. Les états et les nations dorénavant n’ont plus d’ennemis proprement dits. Ils n’ont plus de voisins hostiles qui se réclament d’un territoire contigu du leur et qui les menacent. Il est d’ailleurs significatif à cet égard que l’invasion de l’Afghanistan a été justifiée non parce qu’il s’agissait d’un état ennemi, d’un adversaire dangereux, mais parce qu’il était accusé d’abriter, de cacher et de protéger, un groupe terroriste international, sans territoire fixe, Al Qaïda. Dorénavant, l’ennemi, dont le terroriste est devenu l’exemple paradigmatique, est un ennemi dont l’extériorité est incertaine et ambiguë. Plutôt qu’un ennemi qui habite ailleurs, mais tout près, et vit autrement, au lieu d’une menace aux frontières et un danger évident – comme pouvait l’être l’URSS durant la guerre froide – l’ennemi est invisible, sans adresse ou domicile fixe. La sécurité devient alors de nous protéger contre cette menace diffuse et sans visage.
Cela est cependant impossible. Il fut toujours impossible pour l’état de parfaitement protéger ses citoyens contre l’ennemi extérieur, sauf que l’échec de l’état nation à défendre ses membres, la défaite militaire ne lui était pas imputée. La faute était attribuée à l’ennemi, et la défaite militaire, au contraire, plus que jamais, rassemblait les citoyens derrière l’état.[11] Tandis que l’échec à prévenir ou à déjouer un attentat terroriste ne renforce pas la légitimité de l’état mais la mine. Il conduit à une perte de confiance en la capacité de l’état à protéger ses citoyens. Perte de confiance à laquelle l’état répond en renforçant la sécurité et en restreignant la liberté. En fait, la liberté et la sécurité ne fonctionnent comme des vases communicants que lorsqu’a disparu le clair partage entre l’ennemi extérieur et le danger intérieur, entre l’ennemi et le criminel. La criminalisation de l’aide aux migrants et leur rejet comme de dangereux ennemis témoignent aussi d’un effort désespéré pour recréer un extérieur où peut s’exercer librement notre violence.
Coda
Nos états démocratiques ont perdu la capacité de fonder la communauté dans le transfert unanime de la violence. Il est trompeur de dire simplement que l’état n’a pas renoncé à la violence, qu’il est devenu notre ennemi et qu’il exerce sa violence à tort et à travers, même si cela n’est pas tout à fait inexact. Comme le disait Étienne de la Boétie dans le Discours de la servitude volontaire, d’où viennent au pouvoir tous ces bras par lesquels il pille nos biens et nous emprisonne si ce n’est nous qui lui baillons? C’est nous qui n’avons pas renoncé à la violence. C’est pourquoi l’incapacité de l’état à la repousser vers l’extérieur et à refonder l’unanimité violente est si dangereux.
On peut voir dans les analyses qui précèdent une image catastrophique, apocalyptique de ce qui nous arrive : le transfert unanime de notre violence vers l’état, le dernier rempart institutionnel qui nous protégeait contre notre propre violence s’est écroulé ! Nous sommes perdus, ou du moins acculés à un choix impossible : renoncer entièrement à la violence ou périr. Il y a, selon moi, dans une telle lecture de la situation, une tentation à laquelle Girard n’a pas toujours échappé. Celle de soutenir l’importance de son propos par une urgence absolue et de réduire son message à une décision sans échappatoire.
Il y a cependant dans les analyses mimétiques de Girard une tout autre dimension – qu’on retrouve aussi chez Bobbitt – un aspect que l’on tend à oublier ou à ne pas apercevoir même. C’est le rôle du hasard, de la contingence ou pour mieux dire des accidents et de l’imprévu. La théorie mimétique offre une explication déterministe du comportement humain. Elle décrit des évolutions apparemment irréversibles où chaque événement entraîne nécessairement le moment suivant dans la course effrénée vers l’échec du désir et l’aggravation de la violence. Elle laisse cependant une place à l’accident, aux événements imprévisibles qui, par exemple, dans la vie de Proust ou de Dostoïevski seront l’occasion, mais non la cause, du retournement du romancier romantique en écrivain romanesque. Plus encore, dans son explication du développement des institutions et de l’unité de tous les mythes, la théorie mimétique donne une importance centrale à la contingence. Si le mécanisme auto-régulateur de la violence qui met fin à la crise mimétique constitue la matrice de toutes les institutions humaines, nous devons à des accidents contingents, imprévisibles, que sa répétition ait bifurquée ici en royauté sacré, là en sacrifice, ailleurs ou à un autre moment en domestication des animaux. C’est par hasard aussi qu’elle sera l’occasion de découvertes médicales. La matrice est stérile si elle n’est fécondée par des étincelles de hasard.
Girard lui-même s’est peu intéressé à tous ces accidents contingents. C’est que toute science est par définition déterministe, c’est-à-dire partiale et incomplète, et partant méconnaissance. Elle ignore, au sens propre elle méconnaît, ce qui échappe à son schème déterministe. La tentation de la science est alors de prétendre que tout ce dont elle détourne son regard n’existe pas, ou du moins est sans importance. Pourtant, si Girard s’est peu intéressé à tous ces accidents imprévus, il en a toujours souligné l’importance, car c’est d’eux que vient la richesse du monde. Reconnaissant par là que ce qui échappe à ce qu’il peut décrire est ce qui a façonné l’univers où nous vivons.
Il est faux de penser que nous sommes incapables de vivre sans unanimité et sans détenteur du monopole de la violence légitime. L’état moderne, l’état nation est une invention récente. La fin des sacrifies, la mise en échec du mécanisme victimaire, son incapacité à mettre fin à la violence a été la condition de possibilité de l’état moderne comme moyen violent de nous protéger contre la violence. Nous ne savons pas ce que nous réserve son échec, mais cela n’est écrit nulle part. Pourquoi penser que nous percevons mieux ce que l’avenir nous réserve, que ne le faisait tous ceux qui en 1990 ont annoncé le début d’une nouvelle ère de paix, de tolérance et de démocratie?
« L’amour comme la violence abolit les différences » écrit Girard, mais ce n’est pas de la même façon qu’ils les abolissent. La violence les efface et les rejette et pour ce faire, ira bien souvent jusqu’à détruire ceux qui en sont les porteurs, mais premièrement elle immobilise les différences. La violence les durcit en un vêtement que les agents ne peuvent plus abandonner. Elle absolutise la différence. Elle transforme la différence en un crime, en une menace à la communauté toute entière, un danger qui justifie qu’on la détruise.
L’amour au contraire permet aux différences de ne pas faire de différence. C’est-à-dire qu’elle leur permet d’exister comme différence.
[1] Ils étaient 36 pays en tous. À savoir trente-deux pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, la République Fédérale Tchèque et Slovaque, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Communauté Européenne, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume Uni, Roumanie, le Saint-Siège, San Marin, Suède, Suisse, Yougoslavie ; ainsi que le Canada, les États-Unis, l’URSS et la Turquie.
[2] La guerre civile en Syrie en est un exemple frappant que les multiples interventions des pays occidentaux n’ont jamais eu comme objectif de gagner la guerre, mais de réprimer certains types de comportements ou d’en encourager d’autres de la part de nos « alliés ». Plutôt que des opérations au sein d’une guerre, il s’agissait des étapes d’une négociation.
[3] Voir F. Gros, Les États de Violence, Paris : Gallimard 2006 et aussi A. Hironaka Unending Wars
[4] La conceptualisation même de nos difficultés en terme de crise en témoigne, car l’idée (moderne) de crise suppose un attachement à l’ordre établi. Elle signe l’échec à voir le changement comme un occasion ou une ouverture vers un avenir différent.
[5] Au moment de leur libération M. Spavor avait déjà été condamné à onze ans de prison pour espionnage par un tribunal chinois.
[6] Ph. Bobbitt, The Shield of Achilles, New York : Anchor Books, 2002.
[7] « Dire » au sens de faire exister. N’importe qui peut bien la dire cette différence, mais la faire exister suppose de la mettre en œuvre par des actes de violence. Cela, seuls le font l’état et ceux qui comme les terroristes et les adversaires politiques violents contestent son monopole.
[8] Le second plus gros contingent lors de l’invasion de l’Irak n’était pas celui du Royaume-Unis, 12 000 hommes, mais les 40 000 mercenaires travaillant pour des compagnies de sécurités privées.
[9] P. Dumouchel, Le Sacrifice inutile, Paris : Flammarion, 2011.
[10] La « thématique de la globalisation » plutôt que la globalisation elle-même, car celle-ci en tant que phénomène économique et politique est beaucoup plus ancienne. Le phénomène cependant recevait alors un nom différent, impérialisme ou ordre politique international.
[11] Mais pas nécessairement derrière ceux qui sont au pouvoir.