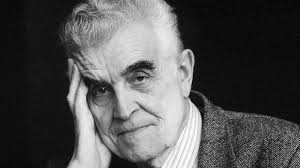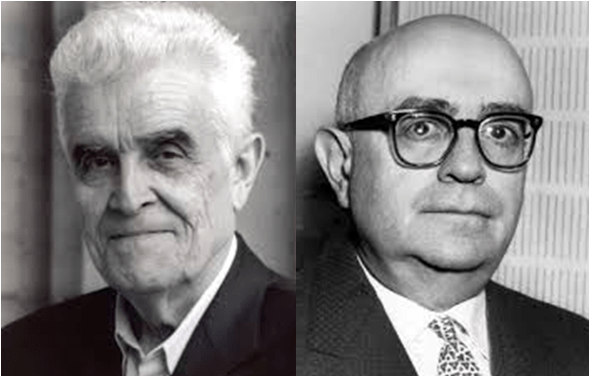par Christine Orsini
En Girardie, l’étrangeté d’un étranger est inquiétante, menaçante, c’est un signe victimaire. Même sans connaître la théorie mimétique, les personnes interrogées au sujet du personnage de Meursault, l’Etranger d’Albert Camus, actuellement au cinéma, conviennent que s’il est finalement condamné à mort, c’est à cause de son étrangeté. C’est en effet la thèse du livre (1942) et aussi celle des deux adaptations filmées du roman, celle de Visconti (1967) et celle de François Ozon (2025). J’ai vu le film d’Ozon, c’est du bel ouvrage, le noir et blanc, la lumière, le casting, le scénario et les dialogues, tout semble attester de sa fidélité au best-seller mondial de Camus. Hélas, soi-disant pour adapter le récit de Camus à la sensibilité du public d’aujourd’hui, le réalisateur a fait des ajouts au roman ; il a voulu souligner par des paroles et des détails visuels l’emprise du colonialisme sur les esprits et, après Kamel Daoud (2), donner une famille, une tombe et un nom à l’Arabe que Meursault tue « par hasard ». Cela n’alourdit pas seulement le film (quand la perfection formelle du roman tient à sa brièveté), cela brouille son message : la lecture post-coloniale du roman est une trahison ; Camus n’a pas voulu faire commettre à son personnage un acte de « petit blanc » ayant une signification sociologique ou politique mais seulement, si je puis dire, une espèce d’acte gratuit, surréaliste (3).
Meursault serait donc, comme Œdipe, un « meurtrier involontaire« , sauf que ce n’est pas son père qu’il a tué (même si dans le roman, se trouve cette envolée du procureur selon laquelle un homme qui ne montre aucun sentiment filial pourrait par son exemple encourager le parricide et de ce fait « être plus coupable que le parricide lui-même » !) ; quant à l’avocat de la défense, commis d’office, les mots que lui fait prononcer le cinéaste pour encourager (en vain) son client à se faire bien voir du tribunal, sont une véritable trahison d’Albert Camus, l’auteur et l’homme : « ce n’est pas votre acte, dit l’avocat, vous n’êtes ni le premier ni le dernier à tuer un Arabe, c’est vous qu’on va juger« . Camus n’aurait jamais écrit cela ! (4) Cependant, le but avoué du livre, et aussi du film, est de faire ressentir le procès de l’Etranger comme une parodie de justice. Pourquoi les juges regardent-ils Meursault comme un monstre ? Pourquoi le condamnent-ils à mort ? Parce qu’il n’a pas pleuré à l’enterrement de sa mère. Telle est la conclusion, paradoxale et provocante, de la préface de Camus à l’édition américaine de son roman : « Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à mort ».
Cette sentence a inspiré à René Girard un texte tout à fait génial : « Pour un nouveau procès de l’Etranger » (1) que je voudrais signaler à l’attention des lecteurs de Camus (ça fait beaucoup de monde), particulièrement ceux que la thèse paradoxale de son chef d’œuvre a laissés perplexes. On ne condamne plus à mort, mais même du temps où la sentence de mort était recevable par un public civilisé, on n’aurait pas condamné à mort un homme au motif « qu’il ne pleure pas à l’enterrement de sa mère ».
Bien sûr, Albert Camus savait cela. C’est pourquoi son personnage, après la première partie du roman, dans laquelle son monologue intérieur nous permet, sinon de le connaître, du moins de nous familiariser avec son étrangeté, est amené, à la fin de cette première partie, par hasard en effet mais aussi par une espèce d’obscure fatalité, à commettre un meurtre. Dans son essai, Girard souligne le « défaut de structure de L’Etranger » : au lieu d’être un jugement a posteriori (obtenu d’après des faits et des témoignages), le jugement qui condamne Meursault relèverait d’un principe a priori (indépendant de l’expérience). Aucun juge, dit Girard, aussi féroce soit-il, ne peut condamner un homme inoffensif, un petit fonctionnaire sans qualités et sans responsabilités, dont la vie est réglée comme une horloge « parce qu’il n’a pas pleuré à l’enterrement de sa mère« . Il faut un crime. Mais comment un homme pourrait-il commettre un meurtre et ne pas en être responsable ?
La seule raison d’accepter « le message ahurissant du roman« , écrit Girard, est de supposer chez l’auteur une intention, celle de soulever l’indignation du lecteur non envers l’assassin mais envers ses juges. « Il faut que Meursault soit innocent pour que les juges soient coupables« . Camus avait besoin d’un « meurtrier innocent pour faire le procès des juges« . Et donc, le meurtre de l’Arabe est le fait du hasard, c’est « à cause du soleil » : un éclat de lumière aveuglant renvoyé par le couteau de l’Arabe déclenche l’acte meurtrier. Le président du tribunal va poser la question : « alors, pourquoi avoir ensuite tiré trois autres coups sur un cadavre ? » Meursault répond comme souvent « je ne sais pas ». A la barre des témoins, Marie, son amante, affirme qu’il ne sait dire que la vérité ; dans la partie « heureuse » du roman, quand elle lui demande, après l’amour, s’il l’aime, il répond « je ne sais pas ». Et quand elle lui dit son désir de mariage, il répond : « je ne sais pas » puis, si elle insiste, « pourquoi pas ? » Ainsi, Meursault ne mentirait jamais, ne jouerait pas un personnage. « Il ne faut pas jouer » dit-il. Voilà un homme qui n’exprime aucun désir, aucune ambition, aucun sentiment, qui ne croit qu’à ses sensations ; Camus l’aura voulu sensuel, aimant le soleil, la mer, les paysages, le corps souple de Marie sous ses robes à fleurs. De son anti-héros, qui n’est pas « une épave » ni un être à la dérive, l’auteur dit sobrement : « c’est un homme pauvre et nu, amoureux du soleil« .
Girard cite un critique, Albert Maquet, qui entre tout à fait dans les vues de Camus : « Le meurtre de l’Arabe n’est qu’un prétexte. Au-delà de la personne de l’accusé, les juges veulent détruire la vérité qu’il incarne. » Quelle est donc cette vérité ? Elle est formulée dans le film, quand on assiste à la colère finale de Meursault, ce moment de violence physique et verbale qui clôture l’entretien que le prêtre essaie d’avoir avec lui et qui correspond au passage du roman où le condamné à mort proclame qu’il a raison, qu’il a toujours eu raison, que « rien n’a d’importance ». Girard écrit : « Meursault est possédé par l’absurde comme certains, dans un tout autre contexte spirituel, sont possédés par la grâce. » La vérité que Meursault incarne, qu’on désigne par le mot d’Absurde, remet en cause les institutions et les valeurs sociales : au fond, les juges le condamnent à mort par un réflexe de défense mais la vérité tout au long du roman et dans le film, est du côté de l’accusé et de l’Absurde, le mensonge du côté des juges.
Girard applique à l’œuvre de Camus la méthode de lecture qui lui a permis de saisir la vérité ou si l’on préfère le savoir anthropologique qui se fait jour par exemple chez Dostoïevski et Proust. Très critique au sujet de la souveraineté esthétique d’une œuvre qui la rendrait intouchable, Girard refuse aussi qu’une discipline extra-littéraire (la psychanalyse par exemple), prétende nous expliquer une œuvre d’art. Dans Mensonge romantique… il montre que le grand romancier se charge lui-même de la tâche critique qui va permettre à son lecteur de progresser dans la connaissance de l’œuvre et surtout dans la connaissance de soi par l’œuvre, en partageant les vérités qu’elle révèle. Ainsi, les œuvres de jeunesse de Dostoïevski et de Proust seront critiquées et surmontées par les œuvres de la maturité. La vérité romanesque va ainsi triompher du mensonge romantique. Il a fallu, montre Girard, une rupture de l’auteur avec ses premières œuvres, fruit d’une conversion romanesque, pour qu’au lieu de simplement les refléter, les œuvres de la maturité révèlent les rapports de désir véritables qui structurent la vie sociale comme la vie intime.
Voici la thèse girardienne : « La Chute correspond, dans l’œuvre de Camus, à une rupture analogue à celle de Dostoïevski». Plus précisément, Clamence, l’avocat des causes perdues, le personnage central du roman, va remettre en question toutes les convictions de l’auteur de l’Etranger. Clamence est un avocat généreux, qui a toujours pris le parti des opprimés contre l’iniquité des juges. Jusqu’au jour où, par une introspection qui produit en lui une conversion, il découvre qu’être vertueux peut être un mensonge, que sa pitié pour les criminels était en réalité une arme secrète pour assurer sa supériorité sur tout le monde et surtout sur les juges, que l’avocat généreux n’est qu’une sorte de juge déguisé, puisqu’il se fait juge des juges. « Quand on se sert de l’anti-pharisaïsme comme d’une arme pour écraser les pharisiens, cela peut devenir une forme plus pernicieuse encore de pharisaïsme. » Ce qui frappe Girard est le fait que La Chute tourne en dérision la conviction bien ancrée chez Camus qu’une vie morale authentique repose sur une hostilité générale à l’égard de tous les juges. Le dernier roman publié de son vivant serait comme une autocritique ou un moment de rupture avec les œuvres antérieures. Et voici la lecture girardienne : « Il faut lire La Chute dans la bonne perspective, c’est-à-dire dans une perspective humoristique. L’auteur, las de la popularité dont il jouissait auprès des bien-pensants de l’élite intellectuelle, trouva une façon subtile de tourner en dérision son rôle de prophète sans scandaliser les purs parmi ses fidèles… La confession de Clamence, c’est celle, au sens large de confession spirituelle et littéraire, de Camus. »(5)
Girard, dans son essai, souligne comme d’habitude qu’il n’a rien inventé et que la vérité qui se cache derrière l’Etranger (on parle ici du roman) aurait été découverte bien avant la confession de La Chute si l’on avait soumis le drame de Meursault à une véritable analyse critique. On ne l’a pas fait et c’est encore Clamence-Camus qui explique pourquoi. Il avoue avoir choisi ses clients « à la seule condition qu’ils fussent de bons meurtriers, comme d’autres sont de bons sauvages. » Meursault, explique Girard, joue dans la littérature de son époque le rôle tenu par le « bon sauvage » dans la littérature du XVIIIème siècle. Sa seule présence suffit à révéler l’arbitraire des valeurs d’une communauté, mais lui, par essence, quoi qu’il fasse, il est innocent. Cela devait suffire pour qu’on accepte le postulat de départ : les juges sont coupables de condamner à mort un meurtrier innocent. Mais quelle vérité se cache derrière l’Etranger ?
Il faut l’affirmer en conclusion de ce billet, la « vérité » qui se cache derrière le roman a échappé à son auteur ; elle a échappé aussi à ses lecteurs et aux cinéastes de talent qui l’ont traduit en images. Elle n’est révélée que dans La Chute, dont Sartre a écrit que c’était de ses romans « le plus beau peut-être et le moins compris ». En un certain sens, L’Etranger et les romans qui suivirent ont été mieux que compris, au point de valoir le prix Nobel de littérature à leur jeune auteur. En un certain sens, L’Etranger semble contredire la théorie mimétique, théorie selon laquelle, au-delà de la sphère des besoins, le désir humain est toujours imité, emprunté à un « modèle » qui peut devenir un obstacle et un rival. Meursault est sans désir, sans modèle, sans rival, il n’a que des besoins et des sensations. Il surclasse « les autres » par sa lucidité et, au cinéma, par sa beauté. Il fréquente un malfrat (c’est la seule solution pour qu’il soit, un jour, par hasard, en possession d’un révolver) mais presque malgré lui, c’est un voisin de palier ; on sent de toutes façons que les autres, quels qu’ils soient, n’ont pour lui aucune importance. On semble très loin de l’homme du souterrain de Dostoïevski, dont le comportement erratique vient de son désir passionné d’être « intégré », remarqué, fêté, envié par ces « Autres » que par ailleurs il méprise. Et pourtant, serions-nous surpris que Meursault, dans sa prison ou lors de l’enterrement de sa mère, prononce ces mots : « Moi, je suis seul, eux ils sont tous » ?
Pour son créateur, Meursault n’est pas seulement un être de fiction, il est un héros métaphysique auquel le lecteur a eu plaisir à s’identifier. Voici un héros qui ne dépend de rien ni de personne, dont l’autonomie fascine. En réalité, selon Girard, Meursault se trouve à un stade plus avancé du désir métaphysique que le personnage de Dostoïevski ; ce désir le possède si complètement qu’il lui échappe, comme lui a échappé son acte criminel. Le jeune Camus, le Camus d’avant la Chute et le discours de Suède, croit à la Différence et à l’indifférence de son personnage, alors que Dostoïevski, quand il écrit le Souterrain, n’y croit plus et révèle le mensonge romantique de son anti-héros. Le génie de Girard est d’avoir vu que, dissimulée derrière le masque, étrange, de sa radicale et fascinante solitude, la vérité de L’Etranger est en réalité la même que celle de l’homme du Souterrain, c’est le ressentiment.
« On nous présente Meursault comme un solitaire totalement indifférent à la société, tandis que la société, elle, est censée s’occuper de près de son existence quotidienne. Ce tableau est manifestement faux : nous savons tous que l’indifférence est du côté de la société et que les préoccupations angoissées sont le lot du malheureux héros solitaire. » Pourquoi ce mensonge ? Girard a montré qu’à un stade avancé d’un désir mimétique qui ne cesse d’apprendre sur lui-même, sa lucidité porte le désir vers une ascèse : ce n’est pas en désirant plus intensément que les autres que l’individualiste moderne échappera à la malédiction d’être « comme tout le monde » ; au contraire, il se distinguera en désirant le moins possible, en ne demandant rien à personne ; ce qui revient à dire que le refus de communiquer est en réalité une tentative de communication.
Girard en apporte pour preuve l’exemple de l’enfant boudeur. Voici un enfant empêché de satisfaire son désir : il va bouder, se retirer à l’écart pour échapper à ses parents. Mais si d’aventure, on l’oublie, il ne supporte ni la solitude ni de revenir quêter leur l’affection ; alors, comme Meursault s’empare d’une arme sans penser à rien, l’enfant s’empare d’une boîte d’allumettes comme ça, par hasard, et met distraitement le feu aux rideaux. Meursault, comme l’enfant, se sera persuadé que son seul désir était qu’on le laissât tranquille. Et pourtant, la dernière phrase du roman exprime son désir des autres, son besoin d’attirer toute leur attention : « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » Dans cette dernière phrase, écrit Girard, « Meursault admet pratiquement que la seule exécution dont il soit vraiment menacé, c’est l’indifférence des autres. » (6)
Notes :
1) Le titre de cet article « Pour un nouveau procès de l’Etranger » est le titre d’un essai écrit en anglais et paru aux USA en 1964 sous le titre « Camu’s Stranger Retried » ; cet essai a été primé aux USA puis traduit en français et édité (L’Age d’Homme, 1976), avec d’autres essais importants, dans un recueil intitulé « Critique dans un souterrain ». Existe en Poche, collection Biblio essais.
2) Kamel Daoud : Meursault, contre-enquête (prix Goncourt du premier roman en 2015).
3) On se souvient de cette phrase de Breton dans le Manifeste du surréalisme (1924), selon laquelle l’acte surréaliste le plus simple consiste à s’armer d’un révolver et à tirer au hasard dans la foule.
4) Le film a été tourné au Maroc, à Tanger. En cette période de tension entre la France et l’Algérie, un tel ajout au texte est politiquement irresponsable.
5) « Albert Camus est mort au moment où une carrière neuve s’ouvrait sans doute devant lui », écrit Girard dans Mensonge romantique…, p.326
6) Toutes les citations qui ne viennent pas du roman, sont tirées de « Pour un nouveau procès de l’Etranger ». J’ai trouvé aussi des informations dans la Biographie de Benoît Chantre, pp. 406 et suivantes ; pp.976 et 977. Ainsi, René Girard cite, comme exemple de l’influence exercée par l’Etranger, le film de Jean-Luc Godard, A bout de souffle (1960). Ces deux œuvres magnifient le « bon criminel », celui que Girard nomme avec justesse et ironie le « délinquant juvénile » ; c’est un hommage rendu à l’irresponsabilité surréaliste.