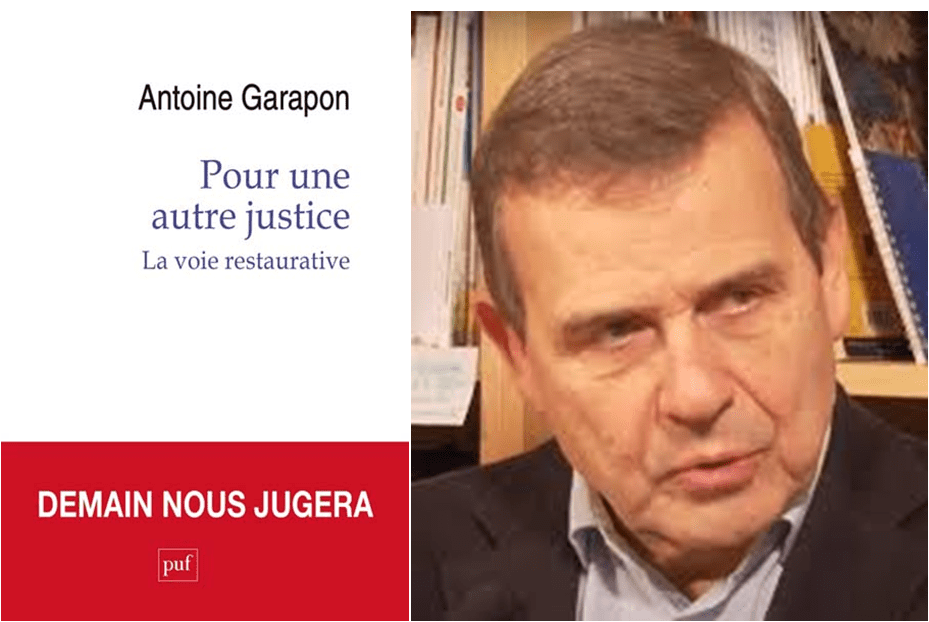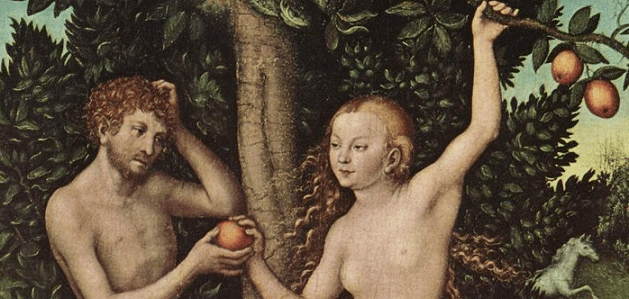
par Hervé van Baren
Précisons le cadre de cette réflexion. Par transgression de l’interdit, je désignerai le dépassement clair et indiscutable des limites qui le caractérisent, par des sujets maîtres de leur esprit, sans pathologies psychiatriques ou troubles du comportement ou états-limites qui altéreraient leur libre arbitre.
On a beaucoup parlé, en anthropologie, de l’interdit. Jusqu’il y a peu, on parlait beaucoup moins de sa transgression. Pourtant, le constat de la différence entre la force des interdits et la réalité de leur transgression est accablant1. Le meurtre est loin d’être un interdit total, il connaît de multiples exceptions : crimes d’honneur dans certaines sociétés traditionnelles, peine de mort, et surtout, évidemment, les guerres, dans lesquelles il est même encouragé de tuer l’ennemi. La récente libération de la parole des victimes d’inceste a conduit à des enquêtes statistiques qui dressent un sinistre tableau : dans une classe de trente élèves, trois subissent des violences sexuelles dans le milieu familial. L’adultère est tellement courant que les conseillers conjugaux avertissent les futurs jeunes mariés : pour partir sur de bonnes bases, faites comme si cela allait vous arriver.
Alors se pose inévitablement la question : si l’interdit est vraiment cette coercition des esprits assorti de punitions sévères en cas de transgression, pourquoi celles-ci sont-elles aussi fréquentes ? L’interdit ne serait-il qu’une épouvantable hypocrisie ?
L’inceste se caractérise par le silence qui entoure l’acte. L’adultère est synonyme de tromperie, de mensonges. Le meurtrier cherche à échapper à la justice par tous les moyens possibles. La transgression de l’interdit semble inséparable des efforts fournis par le transgresseur pour dissimuler ses actes. Lorsque ce n’est pas possible, une stratégie de minimisation de la gravité de ceux-ci sera presque toujours mise en œuvre. C’étaient seulement des attouchements, c’est arrivé par hasard et ça ne signifie rien, je n’ai pas voulu le tuer, c’est un accident. L’interdit est associé à la honte de l’acte qu’il cherche à empêcher.
Est-ce que la transgression est moralement répréhensible ? Oui, toujours, mais cela ne signifie pas grand-chose. Les interdits prennent la forme d’une morale, qui n’en est que l’extension. La morale à son tour façonne les lois. D’un point de vue anthropologique, il nous faut sortir du jugement moral pour éviter la pensée circulaire. Nous devons aborder l’interdit et sa transgression systématique en sortant des clichés.
Pour l’interdit, c’est relativement aisé. Girard rejoint Claude Lévi-Strauss, par exemple, sur le lien entre exogamie et interdit de l’inceste. Pour Levi-Strauss, cet interdit fonde la culture. Pour Girard, il est un des mécanismes de contrôle de la violence, il s’explique par la nécessité de neutraliser les rivalités internes pour la possession des femmes. Retenons l’explication girardienne, plus cohérente à mon avis. Les interdits ont pour fonction de retenir la violence tant que faire se peut.
« Les rites et les interdits fournissent aux hommes les garde-fous contre leur agressivité2 ».
Le meurtre appelle la vengeance, l’inceste détruit les structures familiales garantes de la transmission des valeurs et du développement harmonieux des enfants, l’adultère déchaîne les passions tristes telles que la jalousie et fragilise la famille. L’interdit est un facteur d’ordre social.
Sa transgression, par conséquent, est un facteur de désordre, d’anarchie, susceptible de déclencher la violence collective. Si nous étions parfaitement respectueux des lois, il n’y aurait pas de transgression et la violence resterait contrainte dans des limites acceptables. Girard nous donne les outils pour comprendre la transgression. Ce sont les passions mimétiques qui y conduisent. L’ordre imposé par les interdits se heurte aux désirs, et ceux-ci sont mimétiques, ils ont tendance à s’emballer. Lorsque le désir dépasse une certaine intensité, l’interdit devient impuissant à le contenir : c’est la transgression.
Allons faire un tour du côté de la psychologie. La transgression de l’interdit s’accompagne d’un cloisonnement entre deux réalités qui coexistent dans l’esprit du transgresseur. Le bourreau peut rentrer chez lui une fois ses crimes commis et embrasser tendrement ses enfants. A peine rentré de son rendez-vous amoureux, le conjoint adultère redevient le mari (ou la femme) attentionné et aimant, sans culpabilité apparente. L’incesteur est souvent perçu comme un bon gars, bon père de famille, frère ou oncle. Souvent, le meurtrier ne se voit pas comme quelqu’un de violent. Le transgresseur fait coexister deux mondes dans son esprit (on parle de dissociation cognitive) : celui du respect des lois, et celui de leur transgression.
On retrouve ce clivage dans le mécanisme sacrificiel. Au paroxysme de la crise, les sacrificateurs se transforment en meurtriers sanguinaires, l’instant d’après ils sont redevenus des braves citoyens aux mœurs pacifiques et aimants. Ces deux mondes, semblent-ils, ne se rencontrent jamais.
On retrouve aussi dans la transgression le phénomène de diabolisation. L’assassin justifiera son crime par le côté diabolique de sa victime. Le conjoint trompeur fera porter la responsabilité de ses actes par le conjoint trompé (Je me sentais invisible, indésirable, il/elle était devenu insupportable, etc.) L’incesteur accusera l’enfant d’être pervers et de l’avoir séduit ; plus tard, si la victime porte plainte, il l’accusera de calculs sordides et d’agir par ressentiment. Dans tous les cas, on trouve un mécanisme de rationalisation de l’acte par lequel le transgresseur se dégage de sa responsabilité. Dans la violence, il y a toujours dissymétrie entre la perception du mal chez l’autre et chez soi. C’est la fameuse métaphore évangélique de la paille et de la poutre. La diabolisation de l’autre semble un mécanisme cérébral imperméable à toute forme de jugement objectif, et a fortiori moral.
Lorsqu’on parle de ces sujets, un texte de Saint Paul vient à l’esprit : l’épître aux Romains. Paul y défend la thèse assez surprenante que la transgression a pour origine l’interdit :
La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute…3
Ce qui semble inverser la causalité de l’explication girardienne, pour qui c’est notre nature mimétique qui rend la loi nécessaire.
Mais, si toi qui portes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi et qui mets ta fierté en ton Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui, instruit par la loi, discernes l’essentiel, toi qui es convaincu d’être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l’éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l’expression même de la connaissance et de la vérité… Eh bien ! toi qui enseignes autrui, tu ne t’enseignes pas toi-même ! Tu prêches de ne pas voler, et tu voles ! 4
Saint Paul ne parle pas d’autre chose dans ces versets que de la dissonance cognitive évoquée plus haut. La loi ne permet pas de dépasser cette limitation de l’esprit humain, qui est un moteur de la violence. Le portrait brossé par Saint Paul n’a pas grand-chose à voir avec un homme qui vit en pleine conscience, ce qui se traduit par son manque d’intégrité : il ne fait pas ce qu’il dit aux autres de faire. C’est dans cette séparation entre l’image qu’il a de lui-même et la réalité qu’apparaît la transgression. Saint Paul désigne par le mot loi l’enfermement dans un système de valeurs que le sujet vit dans la dissonance, parce que ces valeurs répriment et s’opposent à ses désirs refoulés. On retrouve le combat freudien entre surmoi et ça.
Avant d’aller plus loin, prenons le temps de revenir à la question initiale : pourquoi transgressons-nous l’interdit ? Nous sommes arrivés à la conclusion que la transgression a pour origine une particularité de l’esprit humain, la capacité de séparer et de cloisonner le monde de la loi et celui des désirs. Il y a pourtant autre chose, et Saint Paul nous le fait comprendre en introduisant une nouvelle variable : la grâce.
La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché avait régné pour la mort, ainsi, par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus Christ, notre Seigneur.5
La clé de ce très déroutant passage se trouve dans la notion de mort et de résurrection. Nous ne pouvons vaincre les forces du mimétisme par nous-mêmes, par la volonté. Notre intention de suivre la loi est sincère (ce que je veux faire…6) mais elle n’est pas de force à résister aux passions mimétiques (… je ne le fais pas7). Il faut une crise, aux conséquences tellement destructrices qu’elle est assimilée à la mort. C’est sur les ruines que peut se reconstruire le nouvel être :
…afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle.8
Cette re-création est parfois vécue par les transgresseurs. Le meurtrier ne peut sortir de son péché que par la prise de conscience des passions qui ont conduit à son geste. Le conjoint adultère devra dénoncer le récit qu’il ou elle s’est soigneusement construit pour ne pas faire face aux conséquences de ses actes sur sa famille et ses proches. L’incesteur devra regarder en face les conséquences tant sur la victime, privée d’être et condamnée à une vie de souffrance et d’ostracisme, que sur la communauté, en premier lieu la famille, obligée pour survivre de se faire la complice de ses actes. Dans tous les cas, la phase de la fin de la dissonance cognitive sera vécue comme une mort, la destruction de toutes les forteresses de l’égo sera complète. Le transgresseur pourra alors renaître à lui-même, se pardonner à lui-même autant qu’il implorera le pardon de celles et ceux qu’il a blessés. Un combat spirituel du même ordre est nécessaire à ses victimes pour que celles-ci pardonnent aussi, sortent du ressentiment. Une chose est sûre : on ne reviendra pas à la situation d’avant la transgression. Le cheminement qui va de l’aveuglement à la conscience en passant par la crise est transformatif de l’être et de la relation entre les êtres. Plus la crise est sévère et bouleverse l’ordre établi, plus elle aura pour conséquence un saut qualitatif qui affectera l’être du transgresseur en profondeur, et aussi des personnes blessées par ses actes.
Le même phénomène se constate à l’échelle de l’histoire. Tous les ordres humains reposaient jusqu’ici sur la loi. La modernité occidentale, dans le sillage du christianisme, a poursuivi son œuvre de destruction du sacré qui a conduit à l’affaiblissement de la loi, et au déchaînement des passions que celle-ci retenait. Le « péché prolifère9 », et c’est au cœur même de cette crise mortelle que la grâce peut agir et la loi atteindre son plein accomplissement.
La transgression est une crise. Dans l’état sacrificiel du monde, la transgression n’attaque en apparence que l’ordre social. Mais la crise nous oblige à changer de monde et à constater que le véritable « péché » n’est pas l’atteinte à cet ordre, mais bien une trahison de l’amour. S’il n’y a pas d’amour au départ, si le meurtrier est un psychopathe incapable d’affect, ou si l’infidélité est commise alors qu’il ne reste aucun sentiment dans le couple, ou si l’incesteur est un pervers incurable, alors il y a seulement faute, atteinte à l’ordre moral. Dans le cas contraire, il y a péché contre l’Esprit, dirait Saint Paul. Nos passions mimétiques détruisent ce qu’il y a de plus précieux en nous et entre nous : l’amour.
La transgression a bien une fonction, comme nous l’apprend Saint Paul : en tant que crise, elle détruit l’ancien monde en nous pour laisser la place au nouveau, un ordre basé sur l’amour. Peut-être ce nouvel ordre ne demande-t-il de remplir qu’une seule et unique condition : renoncer consciemment au désir, ou du moins exercer sur lui un contrôle éclairé, parce que les passions humaines blessent souvent l’autre, et que les notions d’amour et de violence sont strictement antinomiques :
L’amour ne fait aucun tort au prochain ; l’amour est donc le plein accomplissement de la loi.10
1 C’est le constat fait par l’anthropologue Dorothée Dussy dans son livre sur l’inceste : Le berceau des dominations, anthropologie de l’inceste.
2 Paul-Emile Roy, René Girard, article dans Agora.
3 Romains 5, 20
4 Romains 2, 17-21
5 Romains 5, 20-21
6 Romains 7, 15
7 Ibid.
8 Romains 6, 4
9 Romains 5, 20
10 Romains 13, 10