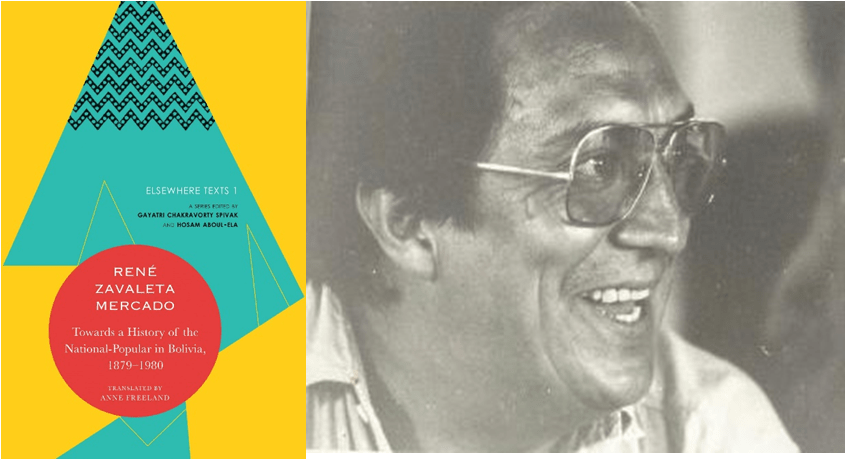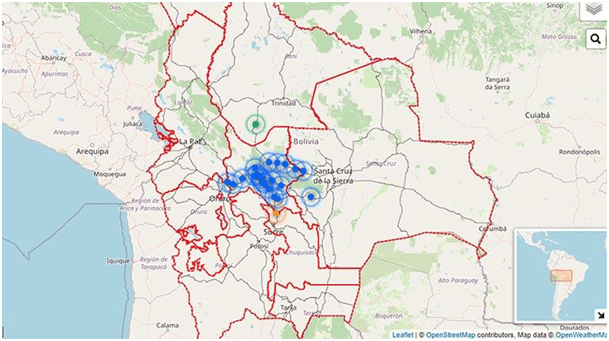par Benoît Hamot
Première partie : capitalisme et monopoles
Le procès des cryptomonnaies est largement engagé. On les accuse de contribuer au réchauffement climatique en nécessitant une quantité d’énergie considérable pour réaliser le « minage » : à lui seul, le bitcoin dépense en électricité environ 165 Twh/an, utilise 1650 milliards de litres d’eau, 2,9 millions de dispositifs informatiques dédiés, et produit 96 millions de tonnes de CO2 dans le but de générer et de contrôler la technologie de la blockchain [1]. On les accuse également d’être des « pyramides de Ponzi », ce qui n’est pas tout à fait exact, car le système de Ponzi – dernièrement utilisé par Bernard Madoff – est destiné à s’écrouler ; cette fatalité est inscrite dans sa logique et ses initiateurs le savent parfaitement. Or il semble que cela ne soit pas le cas pour ces monnaies privées.
En interrogeant cette double accusation, on peut se demander si les cryptomonnaies participent d’une logique équivalente au sacrifice. Les victimes seraient dans ce cas plurielles : ceux qui pâtissent du changement climatique d’un côté et les investisseurs ruinés de l’autre. Mais si le sacrifice tue une seule victime pour que vive la communauté, faut-il tuer la communauté pour que vive la crypto-monnaie qui parviendra à s’imposer ? Ce serait parfaitement absurde. Prise un instant au sérieux, cette inversion structurelle permet-elle d’affirmer que les cryptomonnaies agissent à l’encontre de la logique sacrificielle, qui tend à préserver la vie de tous au détriment d’un tiers exclu ? Rappelons ici que ce tiers est, à l’origine, un être humain appelé à se métamorphoser en une série d’objets de plus en plus anodins, au fur et à mesure d’un processus continu de substitution qui aboutit à la monnaie : c’est l’hypothèse que je défends, en accord avec René Girard, dans Racines sacrificielles de la monnaie.
Si le premier chef d’accusation est indéniable – car prétendre que les cryptomonnaies sont « dématérialisées » relève d’une illusion ou d’un déni – le second invite à réfléchir. Le système de la cryptomonnaie se différencie du système de Ponzi, car il est conçu pour s’établir durablement, et si ses créateurs ont certainement eu l’intention de s’enrichir – et on peut penser qu’ils y ont réussi – ce motif recouvre une plus grande ambition, qui engage l’ensemble de l’humanité. La disparition mystérieuse du créateur du bitcoin (Satoshi Nakamoto) – mais ce nom désigne probablement un groupe de personnes – laisse supposer que ce cartel agit de façon similaire aux cartels de collectionneurs d’« art contemporain » (AC [2]):
« À partir de 2008, la partie la plus haute du marché de l’AC se perfectionne encore et devient aussi une monnaie. C’est un nouveau service qu’offre l’AC, réservé au très haut marché. La valeur d’une pièce d’AC se décide arbitrairement dans un réseau fermé et discret de collectionneurs. Toute « œuvre d’AC », pour accéder à une « valeur faciale », doit cependant avoir en garantie des œuvres identiques placées dans des lieux prestigieux, musée, monument, médias, collections d’hommes célèbres. Cela explique pourquoi le très haut AC est toujours sériel [3]. »
Pour éviter les effets de bulle et de crash, ces « réseaux fermés et discrets » décident de conserver une partie significative des objets à promouvoir, quelle que soit l’ampleur des fluctuations sur le marché. Leurs membres n’agissent donc pas comme de vulgaires spéculateurs ; tout en sachant qu’il s’agit d’une bulle, ceux-là achètent ces produits afin de s’en débarrasser juste avant le crash [4]. Ces réseaux veulent au contraire sécuriser les produits qu’ils ont créés de toutes pièces. Il s’agit d’imposer une idéologie à travers des artistes choisis, qui agissent comme des propagandistes ; il en va de même pour les cryptomonnaies. Les créateurs du bitcoin et les collectionneurs d’AC sont convenu de ne vendre qu’après accord de tous les membres du cartel, afin de ne pas se mettre mutuellement en difficulté, et surtout pour éviter le crash : la perte brutale de la valeur de ces monnaies privées. En pratique, ils s’autorisent à échanger une petite partie en devises, pour la racheter ensuite lorsque l’objet atteint son prix le plus bas.
Le cartel du bitcoin conserverait ainsi une base de sécurité correspondant à 40% de l’ensemble, ce qui aurait permis d’assurer la pérennité de ces monnaies privées sur un marché hautement spéculatif, et ce en l’absence de toute garantie. Les États observent le phénomène avec intérêt : rappelons ici que la monnaie souveraine ne repose sur aucune autre garantie que celle de l’instance politique émettrice, qui dépend, dans les pays démocratiques, du suffrage universel. Le parallèle mimétique entre suffrage et spéculation est ici du plus haut intérêt. Pour tous ceux qui aspirent à transformer les États en entreprises, considérant que le modèle entrepreneurial s’avère plus efficace que le modèle démocratique, il va de soi que la monnaie souveraine doit laisser place à une monnaie privée, et les cryptomonnaies sont élaborées dans ce but.
Je ne m’étendrai pas plus avant ici sur le marché d’un prétendu « art contemporain », car il y aurait beaucoup trop à dire, mais la comparaison donne des résultats intéressants, comme le lancement des NFT (« Non-Fungible Token », jetons non fongibles) : il s’agit d’œuvres (des logos composés de quelques pixels) dont la diffusion sur le réseau internet est calquée sur le « système cryptomonnaie ».
Les créateurs de ces monnaies privées sont récemment parvenus au sommet du pouvoir politique aux Etats-Unis [5], où ils ont toujours été encouragés ; mais Poutine aussi encourage désormais ouvertement le « minage » du bitcoin dans son pays. Les monnaies privées sont la matérialisation d’un phénomène purement spéculatif, qui relève par conséquent du comportement mimétique des investisseurs, mais il ne faudrait pas croire pour autant qu’elles reposent sur un vide conceptuel [6] : elles fondent leur légitimité sur la pensée de Friedrich Hayek. Le célèbre économiste avait théorisé la disparition programmée de tout service public et de l’État, et la privatisation de la monnaie [7]. Pensée apparemment contradictoire, puisqu’elle prône à la fois la libre concurrence et la nécessaire apparition de monopoles ; dans un tel modèle, les acteurs finiraient par s’orienter de façon unanime sur la monnaie privée qui se révèlera la plus stable, et donc la plus sûre. Les cryptomonnaies semblent donc rassembler à la fois les caractéristiques de la « crise mimétique » girardienne – cet état d’indifférenciation et de concurrence généralisée – et sa résolution par polarisation sur un objet unique. Dans l’ordre économique, cet objet particulier, c’est la monnaie.
Par conséquent, les cryptomonnaies sont-elles de « vraies monnaies » ? Aglietta et Orléan ont circonscrit ce phénomène mimétique de polarisation, qui serait toujours en cours pour définir la monnaie. À la différence de leurs analyses, je considère qu’il a eu lieu une bonne fois pour toutes à l’origine de notre espèce : c’est le sacrifice fondateur, mis à jour par Girard à travers le mythe. Le sacrifice originel réalise et exprime l’émergence simultanée de la valeur (le premier dieu) et de son support monétaire (cette part de viande partagée lors du repas anthropophage), mais aussi de la loi, du langage, de l’ensemble des usages sociaux et des rituels. Aglietta et Orléan estiment que cette polarisation se reproduit en permanence, que la monnaie est sans cesse remise en question à travers les rivalités mimétiques, car tous les acteurs économiques sont à la recherche de la « vraie valeur » en imitant leurs semblables : c’est la fameuse métaphore dite « du concours de beauté » (Keynes). Leur hypothèse admet donc implicitement la possibilité pour les cryptomonnaies (« monnaies privées ») d’accéder au statut de véritables monnaies (« monnaies souveraines »), à partir du moment seulement où elles auront réussi à remplacer les monnaies nationales. Mais il faut bien se rendre compte que cet avènement signifie la fin des nations ou des communautés nationales (telles que l’Europe), émettrices de monnaie souveraine.
Tel semble bien être le projet auquel souscrivent les théoriciens et les entrepreneurs libertariens [8] comme Elon Musk, Daniel Vance et Peter Thiel. Cela doit nous interroger tout particulièrement, puisque ces deux derniers disent s’inspirer directement de la pensée « apocalytique » de René Girard. Nous ne pouvons donc pas traiter à la légère une telle entreprise, non seulement en raison de ses effets destructeurs – à moins qu’il ne s’agisse de la « destruction créatrice » chère à Joseph Schumpeter – mais aussi par respect pour la pensée de René Girard lui-même. Il estimait pour sa part que nous étions en train d’assister à l’accouchement, « dans les larmes et la douleur », d’une civilisation mondiale. Ce qui se produit actuellement dans le monde, et pas seulement aux Etats-Unis, correspond-il à cet avènement ? La mondialisation implique-t-elle l’obsolescence programmée des nations et de leurs monnaies respectives ? Faut-il donner raison à des théoriciens tels que Hayek, Orléan et Aglietta, Thiel… qui se rejoindraient, au-delà des oppositions politiques, pour reconnaître dans les crypto-monnaies une monnaie « post-apocalyptique » en devenir ? Je tenterai d’approfondir cette question dans la deuxième partie de cet article.
[1] Delahaye, Jean-Paul. «Bitcoin : une consommation électrique comparable à celle de la Pologne», polytechnique-insight.com, 30 octobre 2024.
[2] « Sigle conçu par Christine Sourgins dans Les Mirages de l’Art contemporain afin de ne pas confondre l’art contemporain avec tout l’art d’aujourd’hui et d’en souligner l’aspect idéologique spécifiquement conceptuel » Aude de Kerros, L’Imposture de l’art contemporain, Eyrolles, 2016 p.13
[3] Ibid. p.95
[4] Un des premiers Rothschild aurait déclaré (selon Alain Minc) : « Je me suis enrichi à force de vendre trop tôt ».
[5] Voir : Cryptomonnaies : Donald Trump octroie une « réserve stratégique de bitcoins » aux Etats-Unis.(Le Monde du 07 mars 2025).
[6] Vide conceptuel tout relatif, puisque la théorie mimétique consiste précisément à lui « donner corps », mais ce faisant, elle en révèle les fondements ; ces « choses cachées depuis la fondation du monde » reposent sur le mensonge sacrificiel. Ce paradoxe est bien connu des lecteurs de Girard.
[7] Friedrich Hayek, The Denationalization of money, London Institute of economic affairs, 1976.
[8] « Libertarien » se décline en : transhumanisme, extropianisme, singularisme, cosmisme, rationalisme, altruisme efficace, long-termisme (selon Torres, cité par Anne-Sophie Moreau, Philosophie Magazine, Février 2025, p.24) mais aussi anarcho-capitalisme ou capitalisme de la finitude : c’est donc en pleine conscience de l’imprécision de ce terme englobant que je me résous à l’employer malgré tout, car il semble convenir à ceux qui s’en réclament.