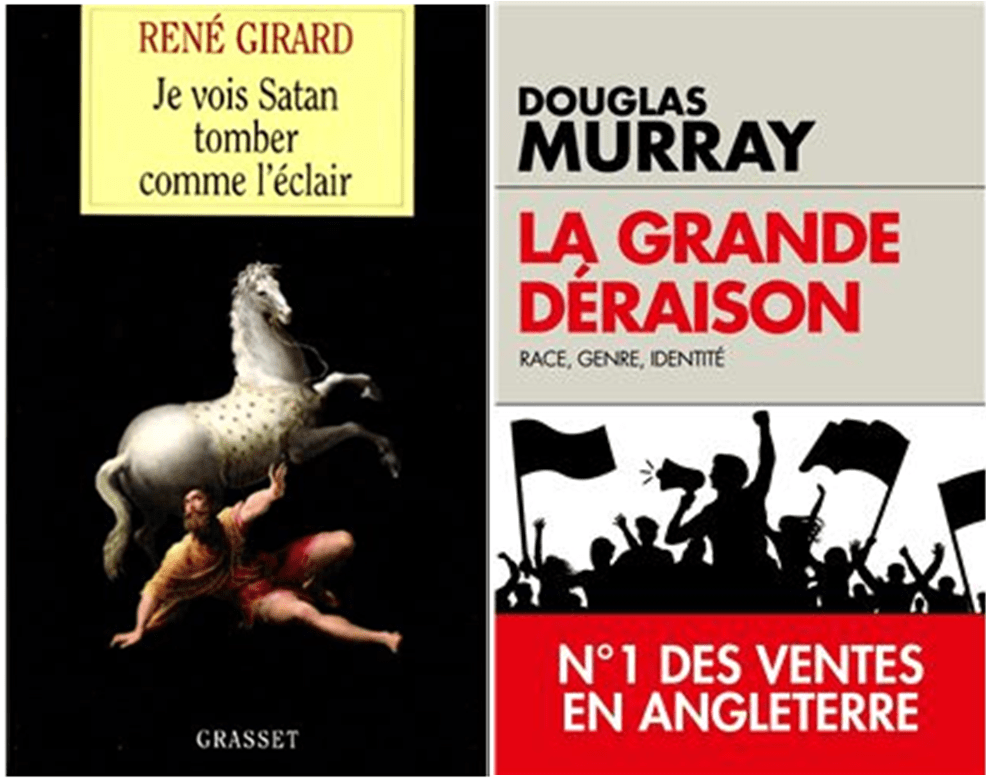
En 1999, René Girard appelait notre attention sur un phénomène qu’il observait sur les campus américains à la lumière de ses préoccupations théoriques : “le souci des victimes”. Il lui a consacré un chapitre de Je vois Satan tomber comme l’éclair. Il avertissait d’emblée : nous allions passer de la pesée des âmes à celle des victimes. Ce phénomène inédit relevait selon lui de la comédie. Sa seconde manifestation semble néanmoins en train de tourner à la tragédie : celle d’un retour à l’oppression et d’une réduction des libertés d’opinion et d’expression, eux aussi inédits depuis trois siècles et demi et la parution du Traité théologico-politique de Spinoza.
Il s’agit bien d’une “grande première anthropologique” que ce souci contemporain des victimes. René Girard pronostiquait que l’appel au souci des victimes irait se renforçant. Il soulignait l’origine chrétienne de cette préoccupation, nourrie du commandement d’aimer non seulement son prochain, mais aussi l’étranger, le pauvre, le malade, le prisonnier, etc. L’archétype de la victime est la “brebis perdue” dont le sort justifie l’abandon du reste du troupeau. René Girard a vu d’emblée que le “souci des victimes est devenu un enjeu paradoxal des rivalités mimétiques, des surenchères concurrentielles”. Les victimes constituent désormais le prétexte à la mise en cause de ses voisins. Il s’agit, selon la parole prophétique de Jésus, de demander compte à la présente génération du sang de toutes les victimes qui l’auront précédée. Poussant plus loin, il voit dans la globalisation la “fin des fermetures victimaires” qui démantèle désormais jusqu’aux “nations dites modernes”, le souci des victimes conduisant à l’unification du monde au terme d’une succession de réformes juridiques : “Dans […] les “droits de l’homme”, […] tout individu ou tout groupe peut devenir le bouc émissaire de sa propre communauté”. Il concluait sur le paradoxe d’une société occidentale la plus prompte à s’accuser, mais dont les fautes sont probablement moindres que les autres sociétés qui, elles, ne s’accusent jamais.
Vingt-deux ans plus tard, la résistance commence à peine à s’organiser face à ce que l’on ne sait plus nommer que par des mots anglo-américains : woke(ness) et cancel culture. Ces deux mots désignent une bonne conscience culpabilisante de celles et ceux qui s’estiment “éveillés” face aux problèmes de certains groupes sociaux maltraités et la volonté de faire un tri dans les événements historiques au moyen d’un tamis moral. Le jugement anachronique des situations passées au regard des idéaux actuels est ainsi devenu la modalité la plus avancée de la bienpensance. Ces deux tendances s’appuient sur une troisième, l’assignation croissante à une identité de groupe : groupe de victimes, ce qui autorise à accuser les autres, groupe de persécuteurs dont le mâle blanc hétérosexuel patriarcal est l’archétype.
Cette assignation débouche au demeurant sur une espérance de convergence des revendications des groupes qui se considèrent comme opprimés, mais elle est aussi un problème logique insoluble : l’intersectionnalité, qui désigne le fait qu’une même personne peut cumuler plusieurs appartenances susceptibles de favoriser son exclusion ou, selon le nouveau lexique, empêcher son inclusion. Ce sera, par exemple, le cas d’une femme noire homosexuelle (en opposition symétrique à l’intersectionnalité persécutrice évoquée précédemment).
Sur cette question des identités, René Girard avait prononcé une conférence importante à Messine qu’il avait intitulée “Les appartenances” et qui a été publiée dans un ouvrage collectif sous la direction de Domenica Mazzù : Politiques de Caïn (Paris : Desclée de Brouwer, 2004). A une époque où le concept d’intersectionnalité n’était pas en vogue et peut-être n’avait pas encore été forgé, René Girard mettait en évidence le paradoxe fondamental de l’identité, mot qui désigne à la fois, au moins en français, l’identique et l’unique : “Notre identité sociale est un entrecroisement, un entremêlement d’appartenances si nombreuses qu’à elles toutes, elles constituent quelque chose d’unique, un être individuel que nous sommes seuls à posséder.” Il comparait cette identité sociale composite au système génétique et parlait d’une “multiplicité individualisante des appartenances.” Il soulignait que “la plupart des appartenances, même les plus humbles, comportent quelque forme d’exclusion, de rejet, et, par conséquent, de violence.” Or nos sociétés supposent dans le même temps la sélection des plus compétents sur laquelle repose leur performance.
Dans ce contexte, les appartenances sont vectrices d’exclusions entre groupes, mais aussi de rivalités mimétiques entre ceux qui les partagent : protectrices à certains égards, elles portent également en germe l’autodestruction. René Girard attribuait au christianisme l’affaiblissement de toutes les appartenances en les désacralisant et, ce faisant, en désacralisant le principe victimaire. Et il se réjouissait il y a une vingtaine d’années de l’affaiblissement consécutif des appartenances tout en notant qu’il abaissait simultanément les barrières traditionnelles au déclenchement des rivalités mimétiques. Dès lors, le recours aux appartenances peut s’analyser comme autant de prétextes, de discours justificateurs à l’origine et à la poursuite de conflits. Ainsi l’indifférenciation croissante de nos sociétés et de notre monde serait le terreau de ces revendications identitaires : “Tous les conflits sont des conflits entre frères ennemis”. Il affirmait que “le conflit des appartenances peut s’aggraver en raison de leur affaiblissement”. Voilà qui me semble éclairer les débats actuels d’un jour nouveau qui permet, selon les vœux que son auteur avait formulés en conclusion de ses propos, de dépasser “les manichéismes idéologiques » dans une perspective “moins noyée dans la naïveté du pour et du contre”.
En moins d’un quart de siècle, les victimes accusatrices semblent pourtant avoir conquis le haut du pavé. C’est l’histoire que narre et dont se désole Douglas Murray, un néo-conservateur qui ne cache pas son homosexualité sans pour autant s’en prévaloir, ce qui lui confère une forme de légitimité pour s’offusquer de la déraison à laquelle conduit l’assignation à la race, au genre ou à l’orientation sexuelle comme marqueurs exclusifs ou “intersectionnels” de l’identité. Son ouvrage, intitulé dans sa traduction française La grande déraison, traite de la manière dont la situation des gays, des femmes, des personnes d’origine ethnique minoritaire et des transgenres est appréhendée à notre époque. Entre compassion et affirmation d’une moralité, il y voit une nouvelle religion et une manière commode de s’affirmer comme quelqu’un de bien.
Il retrouve un des paradoxes mis en évidence par René Girard en évoquant l’affirmation de Patrick Moynihan qui remarquait que, selon les pays, “les plaintes pour violation des droits humains sont inversement proportionnelles au nombre de violations de ces droits”. La vitesse de diffusion de cet état d’esprit progressiste serait liée à “une forme de prosélytisme dogmatique et vengeur (qui) risque, tôt ou tard […] de provoquer l’effondrement de toute culture progressiste”.
Il montre un certain nombre d’impasses et de risques auxquels les revendications et assignations identitaires conduisent. Les revendications à un accès égal au droit s’étaient historiquement fondées sur une conception universaliste, elles s’appuient désormais sur l’appartenance à une catégorie de victimes. S’il est possible, et même parfois encouragé, de changer de sexe, il ne l’est pas de changer de race : une professeure américaine s’étant faite passer pour noire avec le souci de défendre sa communauté d’adoption, a fait scandale lorsqu’il a été avéré qu’elle n’avait pas l’origine raciale qu’elle prétendait. Des représentants de la communauté gay se montrent souvent très hostiles à ceux de ses anciens membres qui optent pour l’hétérosexualité. En s’affranchissant des idéaux de l’universalisme, la volonté d’appuyer ses revendications sur une appartenance raciale emprunte les mêmes catégories de pensée que celles des racistes.
Pour les tenants de l’assignation identitaire, une représentation politique ne serait légitime que si elle est assurée par des représentants partageant les mêmes caractéristiques. Mais une telle position va à l’encontre des conceptions démocratiques. De surcroît, elle aboutit rapidement à des impossibilités, ne serait-ce qu’en subdivisant à l’infini les groupes par le jeu d’une intersectionnalité multipliant les critères : ainsi la grossophobie invite-t-elle à ajouter l’obésité ; les appartenances religieuses sont naturellement une autre catégorisation qui peut être source d’oppressions plus ou moins importantes selon les pays et les cultures et devraient donc également être prises en compte ; l’âge aux effets tout aussi visibles que d’autres différences ne peut être mis de côté, etc. Bref, comme le disait René Girard, l’entrecroisement de nos appartenances fait de chacun d’entre nous un être unique.
Par ailleurs, il est naturellement hors de question de pondérer les éléments d’identité sur une échelle de l’exclusion. Murray demande si, par exemple, une personne blanche en surpoids est égale à une personne de couleur et maigre, du point de vue victimaire. Dans certains cas, les personnes ressortissant de groupes qui se considèrent comme victimes se retrouvent simultanément favorisées au regard d’autres critères : ainsi aux Etats-Unis, les gays et les lesbiennes ont de meilleures rémunérations en moyenne que leurs homologues hétérosexuels ; il en va de même pour les hommes d’origine asiatique dont les revenus dépassent en moyenne ceux des “caucasiens”. Il est donc en pratique impossible de prendre en compte rationnellement l’intersection des caractéristiques sociales.
Au terme de cette brève réflexion, il me semble important d’en revenir aux avertissements girardiens qui restent plus que jamais d’actualité : le double sens contradictoire de l’identité ; l’indémêlable entrecroisement des appartenances qui rend dangereuse toute prééminence de l’une d’entre elles ; la corrélation entre mondialisation et quête d’identité ; la revendication victimaire comme prétexte aux conflits plus que volonté de les dépasser, etc. Face à cette situation de délitement du social auquel nous craignons d’assister, la quête assidue de la vérité sur l’Histoire des cultures et civilisations ainsi que sur le désir humain est probablement la condition non seulement de la fin de nos auto-aveuglements, mais aussi de la réconciliation avec les autres comme avec soi-même.
Nécessaire éclairage girardien sur le phénomène des revendications identitaires. Je propose comme à mon habitude un éclairage biblique en complément.
Après le dévoilement de la violence des cultures et institutions humaines (les fameux quatre cavaliers en apocalypse 6, 1-8) vient nécessairement le temps des victimes :
« Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient porté.
Ils criaient d’une voix forte :
Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?
Alors il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu,
jusqu’à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères,
qui doivent être mis à mort comme eux. » (Apocalypse 6, 9-11)
A chaque lecture de ce passage je suis frappé par l’évocation de ceux qui se posent en victimes et qui s’auto-revêtent d’une robe blanche. Dans le processus apocalyptique qu’est le dévoilement de la violence, nous commençons toujours par nous reconnaître victimes de cette violence, jamais perpétrateurs. La cristallisation de ce sentiment autour d’une identité commune (et toujours artificielle comme le démontre Jean-Marc Bourdin) n’est qu’un des avatars du phénomène. Les disputes de voisinage qu’on retrouve dans les procès au civil en sont un autre exemple.
Girard a ceci de précieux qu’il propose une grille de lecture de ces phénomènes qui s’affranchit des particularités historiques et sociologiques. Il décrit un phénomène de mutation anthropologique déterministe, autrement dit prévisible. La Bible fait la même chose, et c’est le sens du mot prophétie.
Le temps des victimes est le temps de la vengeance. Les victimes d’aujourd’hui sont mues par le ressentiment et la rétribution. Comme le rappelle J.M. Bourdin, et comme l’illustre le verset 11 du texte de Jean, cette étape est porteuse de tous les dangers. En effet, nous sommes tous victimes, mais nous sommes aussi tous bourreaux, voilà la prise de conscience qui manque à ce stade.
Je rejoins la conclusion de Jean-Marc Bourdin. Une fois ce détail rectifié, et seulement à cette condition, nous pourrons choisir en toute conscience entre les deux voies qui nous sont tracées depuis toujours : la vengeance quoi qu’il en coûte, autrement dit le tous contre tous ; ou le pardon, autrement dit la paix.
J’aimeAimé par 1 personne
Oui Hervé, nous retrouvons avec le bifrons victime-vengeur la figure de la spirale mimétique. En y ajoutant le projet de faire masse au moyen de l’assignation identitaire, notre époque favorise son élargissement et sa capacité à y entraîner toujours plus de monde.
J’aimeJ’aime
Merci Jean-Marc. Je suis frappé par le contraste entre cette victimisation de masse et dramatisée et la voix des victimes de violences familiales ou sexuelles (ou les deux), qui réclament rarement une justice vengeresse. Dans le premier cas on participe activement, comme tu le dis, à une spirale infernale, dans l’autre au contraire une parole se libère qui rend intenable la perpétuation du mécanisme victimaire. Cette différence confirme, je pense, le rôle central de la « victime pardonnante » (James Alison) dans la dynamique de sortie de la violence.
J’aimeJ’aime
Oui, tu as tout à fait raison : la victime pardonnante est probablement le seul modèle de désamorçage de la spirale. Et le lien entre libération de la parole/expression de la vérité est un préalable à une possible réconciliation.
J’aimeAimé par 2 personnes
Si l’on se place sur le terrain politique, rien ne semble plus menaçant pour la démocratie que ces revendications consuméristes des droits de l’homme : elles n’expriment pas seulement le ressentiment des victimes, elles refusent absolument le principe d’une universalité de l’homme (hérité du christianisme : « il n’y a plus ni juif, ni non-juif, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, vous êtes tous unis en Jésus-Christ » Saint Paul, Galates 3, 28 ). Ainsi, au lieu d’être le bien commun de toute démocratie et même ce qui sépare la démocratie des régimes anti-démocratiques, les droits de l’homme sont devenus l’objet de rivalités mimétiques. Au lieu d’être « frères » au sens de Saint Paul ou au sens de la fraternité républicaine, les minorités actives se comportent à l’égard de la majorité silencieuse et des autres minorités comme des « frères ennemis », faisant voler en éclats l’idée même de « bien commun ».
Quant à choisir son « genre », conquête ultime du droit d’être « soi-même », il m’a semblé, après avoir regardé le beau documentaire « Petite fille » au sujet d’un petit garçon qui se sent « petite fille » depuis le début de sa vie consciente, que c’est un domaine, le genre, où la liberté humaine est le moins agissante. En effet, semble-t-il, on ne choisit pas son sexe, on naît fille ou garçon, quelquefois fille dans un corps de garçon. Parce que ce n’est pas l’âme qui est dans le corps (comme un pilote en son navire) mais bien le corps qui est dans l’âme !
J’aimeAimé par 3 personnes
Nous retrouvons l’intuition célèbre de Chesterton : « Mais les vertus, elles aussi, brisent leur chaînes, et le vagabondage des vertus n’est pas moins forcené et les ruines qu’elles causent sont plus terribles. Le monde moderne est plein d’anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles, parce qu’isolées l’une de l’autre et parce qu’elles vagabondent toutes seules. »
J’aimeAimé par 2 personnes
OK, Hervé, la machine ne peut pas faire d’erreur. Mais quand je clique pour savoir qui a apprécié mon commentaire, elle m’ajoute à la liste !
J’aimeJ’aime
Tu as raison de t’apprécier à ta juste valeur !
J’aimeJ’aime
Je soupçonne la présence non répertoriée d’une IA qui détecte l’intention inconsciente de l’internaute (un peu à la manière des neurones miroirs). Ceci dit, l’IA, qui partage avec l’humain l’orgueil de se croire intelligente, peut se tromper. J’avais donc tort, toutes mes excuses.
J’aimeJ’aime
La guerre des victimes est semblable à la guerre des egos. L’esprit de vengeance ne nous quitte jamais. Et comme nous avons honte de nous comporter ainsi, nous développons un ressentiment sournois très toxique. Quel est le contrepoison au ressentiment ?
J’aimeAimé par 2 personnes
La conversion. Mais cela ne se trouve pas dans toutes les pharmacies…
J’aimeAimé par 1 personne
La conversion romanesque, celle qu’on trouve chez les bouquinistes :
» Ces descendants des Sodomistes, si nombreux qu’on peut leur appliquer l’autre verset de la Genèse : « Si quelqu’un peut compter la poussière de la terre, il pourra aussi compter cette postérité », se sont fixés sur toute la terre, ils ont eu
accès à toutes les professions, et entrent si bien dans les clubs les plus fermés que, quand un sodomiste n’y est pas admis, les boules noires y sont en majorité celles de sodomistes, mais qui ont soin d’incriminer la sodomie, ayant hérité le mensonge qui permit à leurs ancêtres de quitter la ville maudite. Il est possible qu’ils y retournent un jour. Certes ils forment dans tous les pays une colonie orientale, cultivée, musicienne, médisante, qui a des qualités charmantes et d’insupportables défauts. On les verra d’une façon plus approfondie au cours des pages qui suivront ; mais on a voulu provisoirement prévenir l’erreur funeste qui consisterait, de même qu’on a encouragé un mouvement sioniste, à créer un mouvement sodomiste et à rebâtir Sodome. Or, à peine arrivés, les sodomistes quitteraient la ville pour ne pas avoir l’air d’en être, prendraient femme, entretiendraient des maîtresses dans d’autres cités, où ils trouveraient d’ailleurs toutes les distractions convenables. Ils n’iraient à Sodome que les jours de suprême nécessité, quand leur ville serait vide, par ces temps où la faim fait sortir le loup du bois, c’est-à-dire que tout se passerait en somme comme à Londres, à Berlin, à Rome, à Pétrograd ou à Paris. »
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Proust_-_%C3%80_la_recherche_du_temps_perdu_%C3%A9dition_1919_tome_9.djvu/47
je suis pour la canonisation de Marcel Proust !
J’aimeJ’aime
« Le souci des victimes est devenu un enjeu paradoxal des rivalités mimétiques, des surenchères concurrentielles ». Après cette citation de René GIRARD, cet excellent article en déduit que « Les victimes constituent désormais le prétexte à la mise en cause de ses voisins. »
Aussi, si je reconnais la puissance du concept de James Alison : la « victime pardonnante », je ne pense pas qu’il ait « le rôle central de dans la dynamique de sortie de la violence ».
Je me tourne plutôt vers Jean-Michel OUGHOURLIAN et ses travaux qui ont abouti aux expériences réussies et décrites dans son livre « Le travail qui guérit ». Dans son livre, est décrite une organisation du travail adapté, dont le principe est l’évitement de rivalités mimétiques. Dans ces entreprises c’est le seul mode d’organisation possible pour un travail en équipe de tous ces travailleurs
Mais, c’est un principe qui pourrait être étendu à toute la société avec le refus de la mise en concurrence volontaire entre personne ou groupe.
N’est-ce pas rejoindre René GIRARD, lorsqu’il a décrit les relations entre Paul et Pierre, qui, ayant compris le rôle des rivalités mimétiques les ont conduits à prendre deux chemins séparés.
J’aimeJ’aime
Effectivement, prendre deux chemins séparés est une solution possible, mais je ne suis pas sûr qu’elle soit efficace à long terme. Si cela avait été effectivement le cas entre Pierre et Paul, nous en subirions encore les conséquences à mon avis. Or il y a bien eu discussion, et même dispute (disputatio), et à l’issue de cette rencontre, c’est la voie amorcée par Paul qui s’est imposée, et il y a eu réconciliation. Avec l’aide du Saint-Esprit, n’en doutons pas; c’est lui qui nous indique le chemin. La bifurcation, en ce sens, aurait été littéralement diabolique. Maintenant, en considérant rétrospectivement cette disputation de notre point de vue, il n’est pas certain que la voie défendue par Pierre aurait été mauvaise. Au-delà du fait trivial que nous aurions dû continuer à subir la circoncision (on peut s’en remettre…), cela aurait peut-être atténué l’antisémitisme chrétien ? Nous ne le savons pas, ne le saurons jamais. Mais ce qui est important à retenir à mon avis, c’est que leur disputatio n’a pas consisté à déterminer qui était meilleur que l’autre, qu’elle n’a pas porté sur une question de rivalité, mais sur la question du chemin à suivre en commun, guidé par le Saint-Esprit et non par l’ascendant personnel de Paul.
J’aimeAimé par 2 personnes